Pour les petits et les plus grands, la rédaction de Première Loge vous propose une sélection de cadeaux "lyriques" à offrir à ceux que vous aimez !
LIVRES ET LIVRES-CD
Pour les enfants et les ados
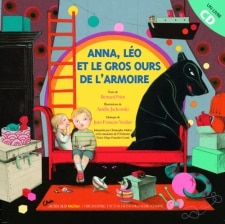
Anna, Léo et le gros ours de l’armoire
Bernard FRIOT, Amélie JACKOWSKI (Illustrateur), Jean-François VERDIER(Musicien).
Dehors, il pleut. Anna et Léo s’ennuient dans le grenier de leur maison de vacances. « Il n’y a que des jouets de bébés, ici. » Tout à coup, un ours des bois – en peluche – sort de l’armoire et demande aimablement s’il peut aller se ravitailler à la cuisine. C’est Gros Bidon, l’ours d’enfance de leur père… Un conte musical plein de sensibilité à écouter dès 5 ans, composé par J.J. Verdier et écrit par B. Friot, récompensé par l’Académie Charles Cros en 2012. (Sabine Teulon-Lardic)
Livre-CD, éditions Actes Sud Junior (14,48 euros)

Forence REYNAUD, Un Chant sous la terre
Isabelle a douze ans et une voix magnifique. Pour remplacer son père blessé, elle doit descendre au fond de la mine, loin de l’air libre qu’elle aime tant et de son rêve de devenir chanteuse. Isabelle est courageuse et ne se plaint pas. Bien au contraire, elle chante sa joie de vivre. Mais un jour, alors qu’elle travaille, une terrible explosion l’enferme sous terre…
À partir de 9 ans
Flammarion Jeunesse – 5,20€
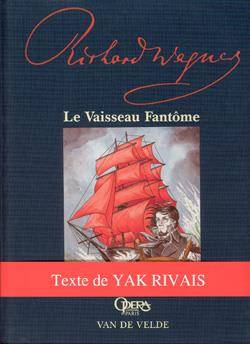
Le Vaisseau fantôme
Texte de Yak Rivais, illustrations de Michel Riu, d’après Richard Wagner
En cherchant bien sur le net, vous pourrez encore trouver ce splendide livre (malheureusement épuisé mais qu’il faut impérativement rééditer !) racontant la légende du Vaisseau Fantôme pour les enfants (à partir de 9 ans), les ados… et les adultes. Texte et illustrations remarquables !
Éditions Van de Velde, 2011 – 17€
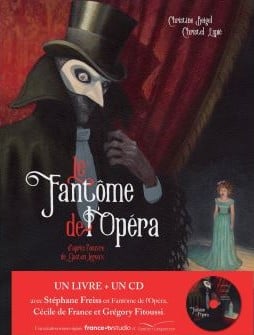
L’histoire du Fantôme de l’opéra racontée par 3 acteurs (Stéphane Freiss, Cécile de France, Grégory Fitoussi) avec de très belles illustrations.
À partir de 7ans
Editions Gautier-Languereau – 24,95€

Le Fantôme de l’Opéra
BD de Christophe Gaultier d’après Gaston Leroux.
Adolescents
Gallimard Jeunesse, 2 vol. – 14,50€ et 14,10€
Pour les grands !

Gérard Fontaine, L’Opéra de Charles Garnier
Pour tout savoir du Palais Garnier, un livre d’art à un prix raisonnable.
Editions du Patrimoine, 35€

Ambroise Thomas, lettres à jacques-Léopold et Henri Heugel.
Sous la direction de Jean-Christophe Branger, Presses universitaires de Lorraine, 2021. 25€
Vous cherchez un cadeau original pour vos amis mélomanes pendant ces fêtes ? Les écrits d’Ambroise Thomas forment une belle proposition avant la reprise d’Hamlet à l’Opéra-Comique en janvier prochain !
Compte rendu ici.
(Sabine Teulon-Lardic)
DVD
Enfants et adolescents

Donizetti, Un Elixir d’amour
Un support idéal pour faire découvrir cette oeuvre aux enfants et reprendre en choeur (et en français !) avec eux certaines pages composées par le compsiteur bergamasque…
(Lire notre critique ici)
Disponible sur la boutique du Théâtre des Champs-Elysées – 11,60€
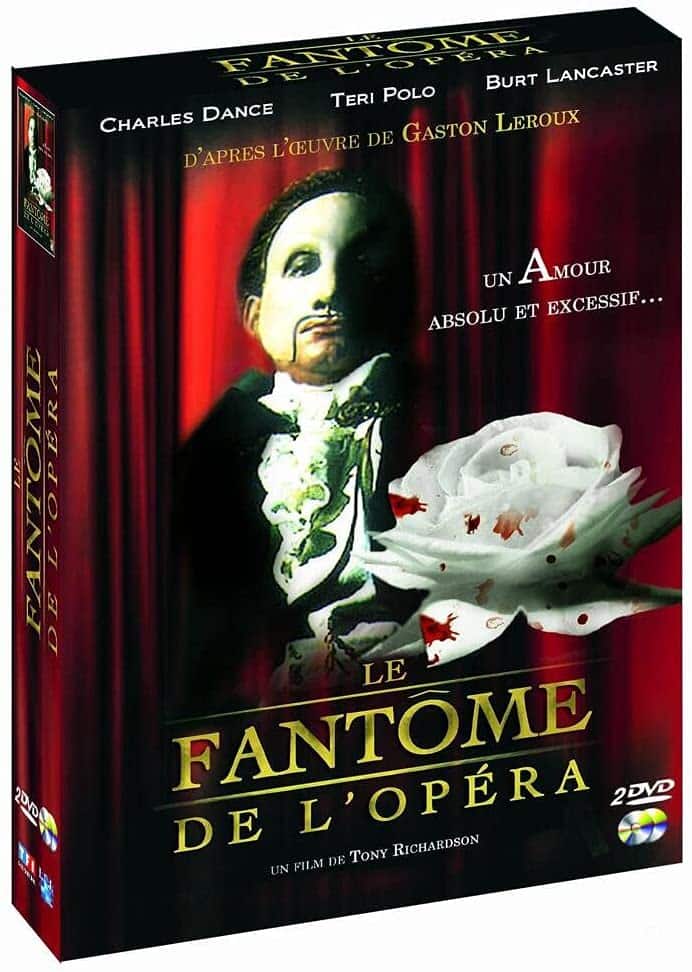
Un téléfilm palpitant de Tony Richardson avec Burt Lancaster, Andréa Ferréol, Charles Dance, Anne Roumanoff. À découvrir avec vos enfants, qui, mine de rien, seront baignés par la musique de Gounod (interprétée par Michèle Lagrange et Jean Dupouy).
2DVD TF1 – 32,95€
Pour les plus grands
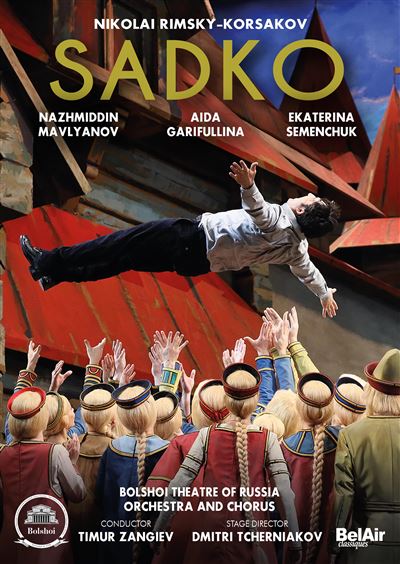
Rimski-Korsakov, Sadko
Un des chefs-d’oeuvre de Rimski-Korsakov, trop rarement entendu en France, dans une version musicalement magnifique. Scéniquement, le spectacle de Tcherniakov séduira autant les partisans de la tradition que les adeptes de la modernité, selon Laurent Bury dont vous pouvez lire le compte rendu ici.
CD
Pour les petits
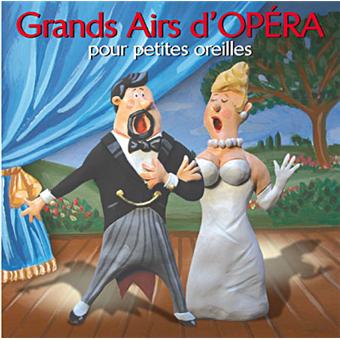
Grands airs d’opéra pour petites oreilles
Il s’agit d’une invitation à plonger dans l’atmosphère riche et magique de l’opéra. L’écoute est progressive. D’abord les instruments de l’orchestre, puis les voix solistes de soprano, ténor et baryton puis les duos, trios et enfin les chœurs. Une comédienne guide les enfants de la fosse d’orchestre au paradis à la découverte des grands compositeurs d’opéra…
Naive, 16€
Pour les grands

Les Itinérantes, Voyages d’hiver
Quelle jolie surprise que ces Voyages d’hiver concoctés par les Itinérantes, trio vocal composé de trois femmes issues de la même école de comédie musicale mais dont les goûts et centres d’intérêt présentent un réjouissant éclectisme : musique classique et ancienne pour Pauline Langlois de Swarte, jazz et chanson pour Manon Cousin, musiques du monde pour Élodie Pont… Si vous ne supportez pas la litanie des chants de Noël fades et sucrés jusqu’à l’écœurement
dont on nous rebat les oreilles jusque dans les mairies, supermarchés ou autres stations-service, ce CD est pour vous : le voyage que vous propose les Itinérantes vous fera redécouvrir certains classiques (Noël nouvelet, Sankta Lucia) avec des oreilles neuves (le Sankta Lucia notamment, dans sa version originale suédoise, n’a rien à voir avec les versions grasses et sirupeuses auxquelles nous ont habitués tel ou tel gosier illustre !). Et surtout, vous découvrirez de nombreuses pièces peu (ou pas) connues, qui vous feront voyager du sud de la France à l’Irlande, du Brésil à la Russie, de la Roumanie à la Toscane, dans une belle alternance de chants religieux ou païens, certains d’entre eux célébrant le solstice d’hiver autant – voire plus – que la naissance du divin enfant.
Pour la critique complète de ce CD, c’est ici !
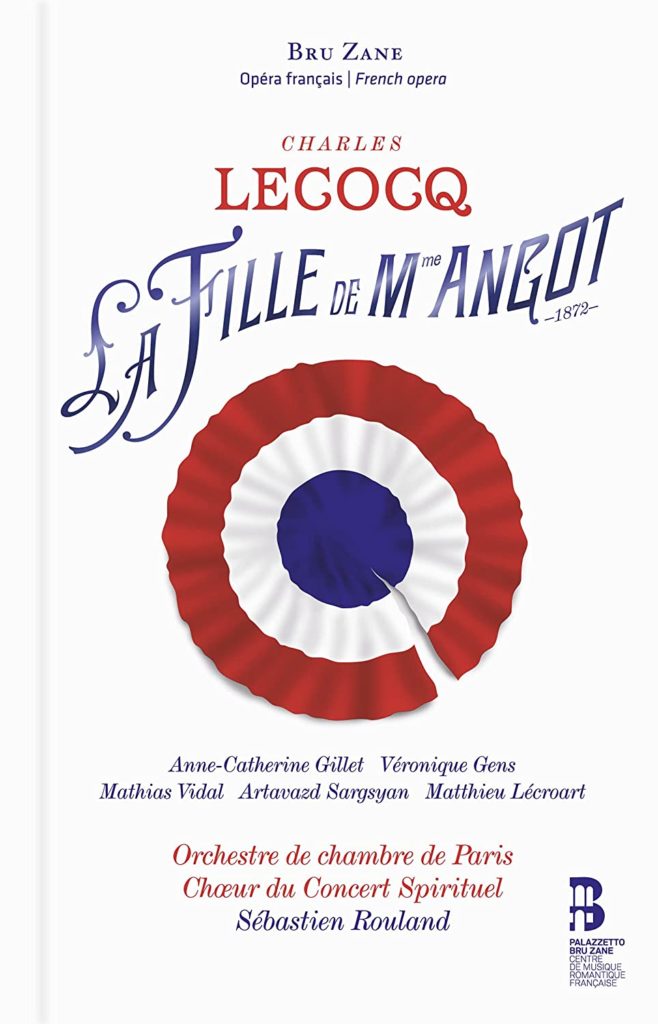
Charles LECOQ, La Fille de Madame Angot
Pour (re)découvrir le chef -d’œuvre de Charles Lecoq, une superbe vesrion discographique d’un concert fort réussi proposé au TCE. Lisez le compte rendu de Laurent Bury ici !
Palazzetto Bru Zane, 27,99€

Bellini, IL PIRATA
Avec Javier Camarena et Marina Rebeka.
Selon Camillo Faverzani (dont vous pouvez lire la critique ici), il s’agit là de la version de référence en studio de cet opéra trop rare de Bellini.
Prima Classic, 3CD – 51,99€

Superbe récital de celle qui chante actuellement le rôle-titre d’Alcina au palais Garnier !
Voyez le compte rendu de Marc Dumont ici…
Mirrors, 1CD Berlin, 17,95€

Duets to die for (Opera Rara)
Un très beau florilège de duos qui, grâce à Opera Rara, nous promène hors des sentiers battus et nous permet d’entendre des pages de Donizetti, Mayr, Lavigna, Rossini, Meyerbeer, Carafa, Coccia Pacini et Mercadante interprétées par Renée Fleming, Nelly Miricioiu, Bruce Ford ou Jennifer Larmore…
1 CD Opera Rara, 16,39 €
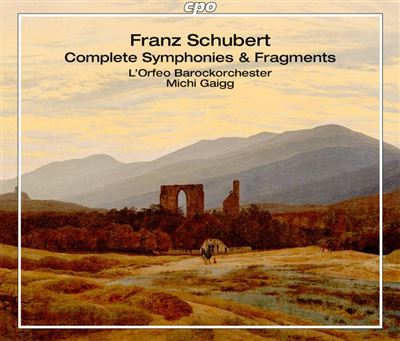
Notre collaborateur Marc Dumont vous propose une idée de cadeau « sans voix » : l’intégrale des Symphonies de Schubert dans une interprétation qui l’a enthousiasmé et dont nous vous livrons la critique ci-dessous.
Schubert, Intégrale des symphonies et fragments
Orfeo Barockorchester, dir. Michi Gaigg.
4CD CPO – 44,99€
OSER SCHUBERT
Voilà qui ne devrait pas passer inaperçu. À plus d’une reprise, l’oreille à l’affut, on grince des dents. Michi Gaigg met en lumière les frottements, tous les frottements d’un Schubert dynamique, cassant. Ici, rien du jeune binoclard hors sol que certains portraits, tant en peinture qu’en musique, nous ont dressés. Schubert empoigne la vie et ses douleurs à pleines dents. Il mord dans la structure orchestrale qu’il dynamite, d’une tout autre façon que son ainé d’un grand quart de siècle, ce cher Beethoven qui l’intimidait tant. Cette fois, nous entendons que lui aussi frayait d’autres recherches, non moins révolutionnaires. Mais le destin en décida autrement et lorsqu’il compose sa dernière et « grande » symphonie, il a 30 ans. À cet âge, Beethoven en était à… sa première.
Voilà des années que cet orchestre et sa cheffe s’attèlent à toutes sortes de répertoires. De Telemann à Rameau, de Gluck à Mozart, de Wagenseil à Mendelssohn. Cette intégrale pas comme les autres est le reflet des concerts donnés en mai 2018 au Festival de Hohenhems. Quelques séances de studios ont suivi immédiatement et d’autres, enfin, en avril 2021[1].
Disons-le d’emblée, en cette période de parité bien ordonnée, cette lecture n’a rien de « féminine » – encore faudrait-il imaginer pouvoir entendre le côté féminin d’une interprétation… Elle est musicale et tant mieux (ou qu’importe !) si on la doit à une femme.
Un conseil préliminaire : pour s’introduire au climat régnant sur cette passionnante intégrale, il faut courir écouter l’Ouverture en ré majeur D 2A[2]. C’est court (3’20) et s’arrête en plein vol (c’est un fragment). C’est loin d’être le meilleur Schubert, mais c’est son premier extrait symphonique retrouvé (il avait juste treize ans) et surtout, l’esprit de l’interprétation de Michi Gaig et se ses complices de l’Orfeo Barockorchester – formidables musiciens, de bout en bout – y est tout entier : conquérant, voire brutal, faisant naître le chant d’un chaos orchestral qui semble devoir beaucoup à celui de la Création de Joseph Haydn. Schubert y apparait clairement en héritier viennois (ici Haydn, à d’autres moments Mozart) ET en chercheur d’un ailleurs orchestral.
Schubert ose. Et l’un des grands mérites de cette intégrale, c’est justement d’oser.
– Oser prendre à bras le corps les partitions schubertiennes. Car nous entendons tout, absolument tout ce qui est écrit.
– Oser défier la tradition des orchestres symphoniques, si loin des sons caressants d’un Karl Böhm avec l’Orchestre Philharmonique de Berlin[3] ou de quelques belles intégrales classiques avec des orchestres modernes, de Wolfgang Sawallisch à Claudio Abbado, de Gunter Wand à David Zinman. Bien sûr, l’Orfeo Barockorchester n’est pas le premier à frayer ce chemin sur instruments anciens. Il suffit de penser à Frans Brüggen et son Orchestre du XVIIIe siècle[4], à Marc Minkowski et Les Musiciens du Louvre[5] ou à Jos van Immerseel avec Anima Etena[6]. Mais ici, la lecture est encore plus radicale.
– Oser reprendre le flambeau d’un Nikolaus Harnoncourt là où il nous l’a laissé au travers de ses trois intégrales : la première avec l’Orchestre de Chambre d’Europe ; la seconde avec le même orchestre, mais en concert, avec des aspérités et une plus grande liberté ; la dernière somptueusement mise en scène par l’Orchestre Philharmonique de Berlin. Dans les trois cas, un orchestre moderne, pas d’instruments « anciens ». Certes, nombre de moments de cette nouvelle intégrale font penser au geste et à la relecture d’Harnoncourt, dans les contrastes, le choix de tempo ou les coup de boutoir. Pourtant, Michi Gaigg y ajoute autre chose par une lecture des partitions aussi personnelle que profonde.
– Oser l’opulence sonore car il ne s’agit pas d’un orchestre dégraissé, épuré comme Roy Goodman et son Hanover Band ou surtout Roger Norrington et ses London Classical Players pouvaient en offrir.
– Mais surtout oser jouer les dissonances écrites par Schubert ! Cela ne s’est jamais autant entendu à ce point : les symphonies de jeunesse – si l’on peut dire pour un homme décédé à 31 ans – celles d’un gamin qui, pour les cinq premières, avait entre 16 et 19 ans, prennent alors un relief tout à fait inattendu. Quant aux huit fragments proposés, tous très courts, voire anecdotiques, tous de la main de Schubert seul, ils différent de beaucoup de ceux que nous offrait Neville Marriner dans son intégrale du début des années 80[7], tous complétés et orchestrés par Brian Newbould. Rien de tel ici : Schubert, rien que Schubert, tout Schubert.
La 1ère symphonie donne le ton, avec ses coups de boutoirs, ses élans d’un cheval fougueux, nerveux, qui se cabre et refuse le beau son. Le final, coruscant à souhait, l’affirme : l’adolescent Schubert (il a alors seize ans) est bien en recherche d’une écriture autre.
Dans la 2e symphonie, le second mouvement donne à entendre la violence derrière le bucolique d’un thème léger et d’une clarinette virevoltante comme un elfe ; une violence qui éclate, comme des coups de hache aux assauts brutaux, assénés par le pupitre des violons. Ici comme pour l’ensemble des autres symphonies, le menuet est coupant, la danse frénétique. Et le final nous bouscule et nous emporte, écho d’un monde brutal, celui des guerres napoléoniennes qui hantent les partitions beethovéniennes comme celles de Schubert.
On aurait tort de faire de cette musique un monde orchestral sans contingence, délié de tout rapport au monde. Lorsque Schubert compose ses premières symphonies, le traumatisme du bombardement et de l’occupation de Vienne par les troupes françaises est encore brûlant, tout comme les innombrables batailles qui ensanglantent bien plus que l’Autriche, l’Europe entière. Est-ce vraiment étonnant si le 16 mai 1814, il compose un lied à la gloire des soldats vainqueurs des armées impériales ? Die Befreier Europas in Paris chante joyeusement « Ils sont à Paris, les héros libérateurs de l’Europe ! »
Rien de plus légitime que de faire entendre les échos du fracas des combats, des charges de cavalerie, des chocs des armées dans ses musiques instrumentales. Alors, le final de la 3e symphonie devient une course à l’abîme, non sans le contrepoint d’un certain humour grinçant (les bois) mais loin du caractère solaire que l’on y décèle sous d’autres baguettes.
Avec la 4e symphonie, sous-titrée Tragique, là où la version Brüggen est vif argent, là où Immerseel court un peu trop la poste en survolant les tensions malgré un très bel ensemble instrumental, Michi Gaigg choisit – là encore – le drame qui couve puis éclate comme un orage, violent.
Et pour la 5e symphonie, la tendresse du thème qui ouvre l’œuvre n’est pas au rendez-vous : là encore, Schubert est pensé comme musicien intranquille et non comme jeune homme rêveur regardant vers un XVIIIe siècle fantasmé.
Ce qui fait entendre une introduction de la 6e symphonie aussi grinçante que mystérieuse. Là encore se retrouve le foisonnement instrumental fouillé par Michi Gaig. Petit bémol avec le final, pris dans un tempo trop retenu, manquant de brillance, d’allant, de feu-follet et simplement de folie. La péroraison finale en devient trop insistante.
En 1822, ce sont presque cinq années qui se sont écoulées dans la vie de Schubert depuis cette série de six symphonies de jeunesse. Il a 25 ans et revient à la symphonie avec sa 7e ; il s’agit bien de L’Inachevée, celle qui est souvent numérotée 8e. Et les premières notes de contrebasses font frémir. D’emblée, le climat est là – sombre, tendu, à vif. Les cors, superlatifs, creusent le mystère. Le jeu sans vibrato des cordes (là comme partout) dessine en ce premier mouvement un paysage désolé, nous plongeant dans l’univers halluciné cher aux tableaux de Caspar David Friedrich. L’un brosse la tragédie des paysages, l’autre fait ici bruire la tragédie du paysage intérieur. Les cordes bouillonnent, les cuivres gémissent, le temps semble se répéter sans jamais revenir au même. Interprétation hallucinée qui nous laisse au bord de l’abîme. Et le second mouvement n’est guère plus serein, même si là se trouvent les moments les plus poétiques de l’intégrale.
Celle-ci se clôt avec la 8e, la Grande, chef-d’œuvre parmi les chefs-d’œuvre de l’art occidental, là où se trouve l’abîme que Schubert creuse, invente, ressasse. La voie est neuve, le cheminement âpre.
L’appel de cor qui introduit la dernière symphonie n’a rien de mystérieux ni de fantomatique dans les choix de Michi Gaigg. Il appelle à la marche. Et le tempo est allant, conquérant même. La texture orchestrale se déploie, lumineuse, analytique, impressionnante de maitrise. Après le parcours des précédentes symphonies, on aurait pu attendre un regard profondément métaphysique. Il n’en est rien. C’est la fougue de la jeunesse qui éclate ici. Mais se dessine au fil du mouvement une vraie course à l’abîme avec ses accélérations, ses montées d’adrénaline, ses doutes, dans d’impressionnants tutti orchestraux d’une rare clarté polyphonique.
Le deuxième mouvement est tout aussi allant, avec une clarinette qui semble parfois, subrepticement, se colorer de sons klezmer, avec des coups d’archet tranchants, des timbales coupantes, des cors mordorés. La montée au climax n’en est que plus angoissante. Là réside l’abîme. Et le silence qui suit, le thrène désolé qui reprend vie, nous clouent littéralement sur place dans un effroi que la fin ne vient pas guérir, malgré la mélodie qui se voudrait consolatrice.
Le scherzo se voudrait réparateur, dans un tempo retenu (trop ?). Ce n’est malheureusement pas le moment le plus inspiré de cette intégrale. Il y manque le mystère et l’inquiétude.
Dans le final, là où Frans Brüggen court la poste, de façon trop mécanique et vaine, là où Marc Minkowski fait ronfler son orchestre de façon un peu démonstrative et raide, là où Jos van Immerseel manque de tension dramatique, Michi Gaigg choisit la luxuriance instrumentale. Mais bien que très abouti sur le plan orchestral, l’allegro vivace final manque de cette folie abyssale que semble découvrir Schubert tout en composant. Les coups de boutoirs sont parfois un peu trop systématiques. Mais les frottements harmoniques, les recherches de sonorités nouvelles sont bien là, obsédants.
On aura compris que dès les premières compositions schubertiennes, Michi Gaigg et son orchestre complice pensent un édifice cohérent, une recherche d’un Schubert totalement occupé, dès l’origine, à s’inventer un nouveau monde. Aucune césure ne vient isoler les 7è et 8è des six premières symphonies. Il n’y a donc pas trace d’une improbable écriture de jeunesse puis d’une écriture toute autre, aboutie, regardant vers des horizons inconnus. Les interprètes proposent un ensemble qui se construit, année après année, dans la quête d’un ailleurs orchestral. Et cela fonctionne parfaitement.
Un regret toutefois : que cette relecture oublie trop souvent la tendresse qui est aussi celle de nombreux moments musicaux schubertiens. Refus de l’épanchement ? Est-ce trop systématique que de jouer à ce point du scalpel et de la force brute, voire brutale ? Est-ce trop insister ici sur tel trait de cor ou de contrebasse, là sur celui de la clarinette ou du hautbois ? Et sur un contrepoint jusqu’ici in-entendu ? Pourtant, aucun maniérisme ne vient perturber l’écoute qui suit une vision pensée, cohérente, assumée.
Menée de main de maître[8], cette intégrale enflamme et nous secoue. Elle divisera peut-être – sans doute. Trop brutale ? Mais un travail en profondeur sur les partitions comme sur les balances orchestrales, les contrastes et étagements des plans sonores ainsi que les choix interprétatifs mêlés à une prise de son large, chaude, superlative (parfois au détriment des pupitres de cordes) fait de cet enregistrement un des plus réussis et novateurs. De bout en bout, ces prises de son claires, précises, larges et d’une parfaite acuité permettent une écoute passionnante. Elles ne sont pas pour rien dans la réussite et la fluidité musicale de cette intégrale qui fera date. Les choix interprétatifs y suivent leur chemin, cohérent. Schubert y apparait violent, torturé, inquiet – souvent abrupt. Moderne et en recherche d’un autre monde symphonique.
Il fallait oser aller à ce point chercher Schubert là où il est vraiment : dans le laboratoire sonore d’une intranquillité conflictuelle.
—————————————————–
[1] Les musiciens avaient déjà enregistré une 5è symphonie publiée en 2012 chez Deutsche Harmonia Mundi.
[2] Il suffit de prendre le premier CD à la plage 5.
[3] Enregistré entre 1963 et 1971, réédité en CD par DG en 20.
[4] Enregistré entre 1991 et 1997, réédité en CD par Decca en 2015.
[5] Enregistré en 2012 chez Naïve.
[6] Enregistré entre 1996 et 1997, réédité en CD par Naïve en 2012.
[7] Enregistré entre 1982 et 1984, rééditée en CD en 2002 par Philips.
[8] Difficile de féminiser l’expression en « main de maîtresse » qui ferait alors pencher l’écoute vers une sorte de sado-masochisme accolé à Schubert…


