Première suisse de l’opéra de Prokofiev Guerre et Paix à Genève
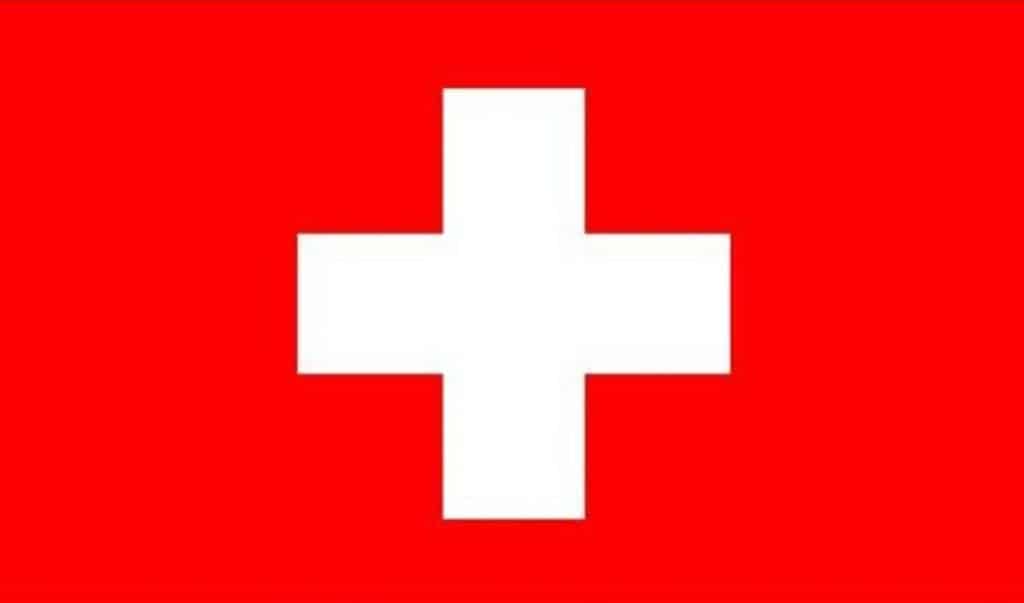
Monté pour la première fois en Suisse, l’opéra Guerre et Paix, dans la vision proposée par Calixto Bieito, remporte un très grand succès.
D'un roman complexe à un opéra épique
Ouverture de saison grandiose à l’Opéra de Genève : l’une des œuvres les plus monumentales du XXe siècle y est montée avec des moyns on ne peut plus importants. « Une inauguration plus grande que nature », déclare Christopher Park, Rédacteur/Médiateur culturel au GTG. Qu’il s’agisse de la direction d’orchestre, de la mise en scène ou de la distribution, le théâtre du lac Léman réunit une équipe offrant une représentation mémorable – et c’est la première fois que l’opéra de Prokofiev est joué en Suisse.
« Paix et guerre » : c’est plutôt ainsi que cette version du chef-d’œuvre de Tolstoï aurait dû être intitulée ! Dans le livret, écrit par le compositeur lui-même et son épouse Mira Mendelson-Prokofieva, la première partie est consacrée aux événements de la paix, avec l’histoire d’amour contrastée du prince Andrei Bolkonsky pour la jeune Nataša Rostova, âgée de 15 ans, tandis que la seconde nous plonge dans la bataille de Borodino, au cours de laquelle s’affrontent l’armée française dirigée par Napoléon Bonaparte et l’armée impériale russe commandée par le général Kutusov.
Le compositeur résout la tâche difficile consistant à transformer ce roman complexe, dans lequel les affaires privées de la noblesse russe et les événements de la guerre sont étroitement mêlés, en esquissant treize scènes séparées par des césures claires. Dans les sept premières (formant la première partie), les moments mélodiques et les références aux danses abondent dans la musique. La deuxième partie voit le chœur intervenir massivement pour donner un ton épique à l’événement essentiel que constitue la campagne de Napoléon en 1812 – que Prokofiev revit comme la fuite découlant de l’invasion nazie en 1941. C’est également la partie la plus retravaillée par le compositeur en raison des interférences politiques ayant imposé une plus grande importance accordée au volet russe, notamment au personnage de Kutusov qui devait apparaître comme un hommage explicite à Staline.
La vision originale de Bieito
L’aspect ouvertement idéologique de l’opéra est remis en question par la lecture de Calixto Bieito qui, avec la dramaturgie de Beate Breidenbach et la scénographie de Rebecca Ringst, convoque en première partie l’atmosphère surréaliste de El ángel exterminador, le film de Luis Buñuel de 1962 dans lequel les invités d’une soirée d’après-théâtre ne peuvent quitter la maison de leurs hôtes. Ici, les nobles de Saint-Pétersbourg, invités à un bal à la veille du Nouvel An 1810, dans les élégants vêtements contemporains d’Ingo Krügler, ont un ennemi invisible, inconnu, incertain. Après Napoléon et Hitler, quelle est la menace aujourd’hui ? Peut-être sont-ils eux-mêmes l’abîme qu’ils doivent redouter ? Peut-être doivent-ils craindre l’énigme que constitue leur propre humanité ?…
Dans la mise en scène de Bieito – le metteur en scène se produit pour la première fois au théâtre de Genève –, la scène reproduit fidèlement le boudoir de Maria Aleksandrovna, née Maria de Hesse-Darmstadt, épouse de l’empereur Alexandre II, avec ses stucs dorés, les fauteuils et canapés en velours rouge, les cariatides aux seins opulents, le grand miroir ovale sur le mur du fond, qui est ici un écran sur lequel sont projetées les images vidéo de Sarah Derendinger et permet ensuite d’apercevoir des ruines fumantes à l’extérieur. Comme dans le film de Buñuel, les aristocrates passent leur temps en conversations oiseuses, inconscients du monde extérieur où plane une sombre menace, et le fait que les meubles empilés suite aux disputes opposant les personnages les uns aux autres se transforment en barricades (comme l’annonce le colonel Denisov à la fin du septième tableau : « Un courrier de Vilno : Napoléon a déployé des troupes à la frontière. Ça ressemble à une guerre ») apparaît presque le fruit du hasard.
Jusqu’alors, les escarmouches s’étaient limitées à des menaces de duels, des projets d’enlèvement, des tentatives de suicide et des querelles familiales. Dans l’environnement épuré sur lequel le rideau avait été tiré, les personnages étaient coupés du monde par un tissu translucide, protégés de la poussière de l’histoire – mais pas d’eux-mêmes. Nataša est la seule à errer dans ce paysage spectral et son innocence enfantine contraste avec le réveil douloureux des différents invités du bal. Comme dans le film de Buñuel, des choses étranges se produisent ici, que Bieito transforme en scènes théâtrales étonnantes, comme les boîtes à pizza dont les intérieurs métalliques deviennent d’abord des miroirs, puis des pièces d’armure scintillantes.
Dans la deuxième partie, il n’y a plus de place pour le sarcasme : le plafond de l’élégant salon se déchire, les murs se dressent de manière menaçante au-dessus des personnes présentes, les vêtements élégants sont couverts de bandages sanglants, une maquette du Bolchoï, avec son quadrige en bronze verdâtre, est d’abord construite puis détruite, ses pièces étant utilisées en tant qu’armes. Les écrans vidéo sur lesquels un ours avait été aperçu – symbole de la Russie, mais aussi animal présent à la fois dans le roman et dans le film de Buñuel – sont maintenant teintés de rouge, et sur le refrain final laudatif « Gloire à la patrie, à la sainte patrie, gloire à l’armée de la patrie ! Gloire au maréchal Koutouzov ! Hourra ! », les foules en liesse permettent un parallèle cynique avec les insectes qui, sur les écrans verts, s’agitent sans cesse dans une activité vaine et impitoyable. Le cauchemar surréaliste mis en scène par Bieito touche ici le fond d’une vision pessimiste que les adaptations imposées à la musique de Prokofiev n’ont pas réussi à altérer. Guerre et Paix, l’avant-dernière œuvre de Sergueï Prokofiev pour le théâtre, prend ici des couleurs et un aspect différents de celui, épique, élogieux et patriotique, qui avait été demandé au compositeur – et devient une œuvre beaucoup plus proche de notre désenchantement.
Alejo Pérez, un chef aux évidentes affinités russes
La lecture de Bieito bénéficie du précieux soutien musical d’Alejo Pérez, un jeune chef argentin déjà familier de la musique russe : outre un Ange de feu à Rome (2019) et L’Amour des trois oranges (2018) de Prokofiev, on lui doit également Eugène Onéguine (2017), Le Nez (2013) et Lady Macbeth (2010). Le défi consistant à diriger un immense opéra – Pérez opte pour la dernière version, dans laquelle il procède néanmoins à des coupes réduisant la représentation à moins de quatre heures, entracte compris – avec 28 solistes, 75 choristes et un orchestre massif, est honorablement relevé. La couleur orchestrale différente des deux parties est mise en valeur à juste titre et le poids du son ne submerge jamais les chanteurs. Les oasis mélodiques et les valses nostalgiques de la première partie contrastent avec les interventions instrumentales et chorales massives aux résonances livides et métalliques de la seconde partie. Ici, comme dans le Boris de Moussorgski, le chœur est l’un des protagonistes de l’œuvre, incarnant le peuple russe (le début de la deuxième partie fait froid dans le dos…), les volontaires, les soldats russes, les soldats français, les cosaques, les moscovites, les anciens prisonniers. Dirigée par Alan Woodbridge, les chœurs du théâtre ont donné une performance remarquable en termes de densité, d’intonation, de musicalité et, pour autant que je puisse en juger, de diction.
Une distribution à la hauteur de l’enjeu
La distribution compte de nombreux chanteurs russophones, notamment les basses Alekseij Tikhomirov (Prince Nikolaj Bolkonski) et Dmitrij Ul’ianov (Général Koutouzov), les barytons Alekseij Šišliaev (Dolokhov) et Alekseij Lavrov (Napoléon Bonaparte). Le baryton allemand Björn Bürger, qui a été très admiré dans le rôle de Papageno à Paris et à Glyndebourne, endosse ici le rôle du prince romantique Andrei Bolkonski, qu’il sert par un instrument vocal flexible et une présence scénique magnétique. La métamorphose qu’il propose du jeune homme amoureux qui, plein de joie, escalade littéralement les murs en un combattant mourant qui revoit enfin sa bien-aimée, hélas désabusée, est convaincante et émouvante. Tout comme la prestation de Ruzan Mantashyan en Nataša, soprano arménienne d’une grande personnalité et d’une grande puissance expressive, qui a remporté les applaudissements les plus nourris du public.
Chez les femmes, les voix de mezzo-soprano de Lena Belkina (Sonia) et d’Elena Maximova (Comtesse Helena Besoukhova) se sont distinguées. La basse Eric Halfvarson dans le rôle du comte Ilia Rostov a également été particulièrement appréciée du public, tandis que la voix claire du ténor Alexander Kravets a donné du corps à Platon Karataev, la figure de l’innocent si chère à la littérature russe. Se distinguent également, de personnalités opposées, le triste Pierre Bezuchov et le bel Anatole Kuragin : le premier (Daniel Johansso) « libère les paysans et crée des hôpitaux », tandis que le second (Ales Briscein) est « une canaille, un criminel ». À Daniel Johansson (dans le rôle du comte Besoukhov) échoient des pages au lyrisme expansif qui n’auraient pas déplu à Puccini et que le ténor suédois chante avec beaucoup d’élégance et de facilité. Aleš Briscein, quant à lui, donne au personnage de Kuragin juste ce qu’il faut de culot avec son timbre de ténor distinctif et pénétrant. Tous les personnages, pour l’essentiel, se voient attribuer les voix idoines dans cette production qui a suscité l’enthousiasme inconditionnel du public.
Prince Andreï Bolkonski : Björn Bürger
Prince Nikolaï Bolkonski : Alexey Tikhomirov
Princesse Maria Bolkonski : Liene Kinca
Comte Ilia Rostov : Eric Halfvarson
Natasha Rostova : Ruzan Mantashyan
Sonia, sa cousine : Lena Belkina
Comte Pierre Besoukhov : Daniel Johansson
Comtesse Helena Besoukhova : Elena Maximova
Maria Akhrossimova : Natascha Petrinsky
Anatole Kouragin : Ales Briscein
Dolokhov : Alexey Shishlyaev
Général Koutouzov : Dmitry Ulyanov
Napoléon Bonaparte : Alexey Lavrov
Colonel Denisov : Alexander Roslavets
Platon Karataïev : Alexander Kravets
Gavrila : Alexei Botnarciuc
Orchestre de la Suisse romande, chœur du Grand Thépatre de Genève (Alan Woodbridge), dir. Alejo Pérez.
Mis en scène : Calixto Bieito
Scenographie : Rebecca Ringst
Costumes : Ingo Krügler
Lumières : Michael Bauer
Vidéo : Sarah Derendinger
Dramaturgie : Beate Breidenbach
Guerre et paix
Opéra en 13 tableaux de Sergueï Prokofiev d’après Tolstoï, livret du compositeur et de Mira Mendelsohn, créé le créé le 12 juin 1946 au Théâtre Maly de Leningrad.
Représentation du lundi 13 septembre 2021, Grand Théâtre de Genève.








