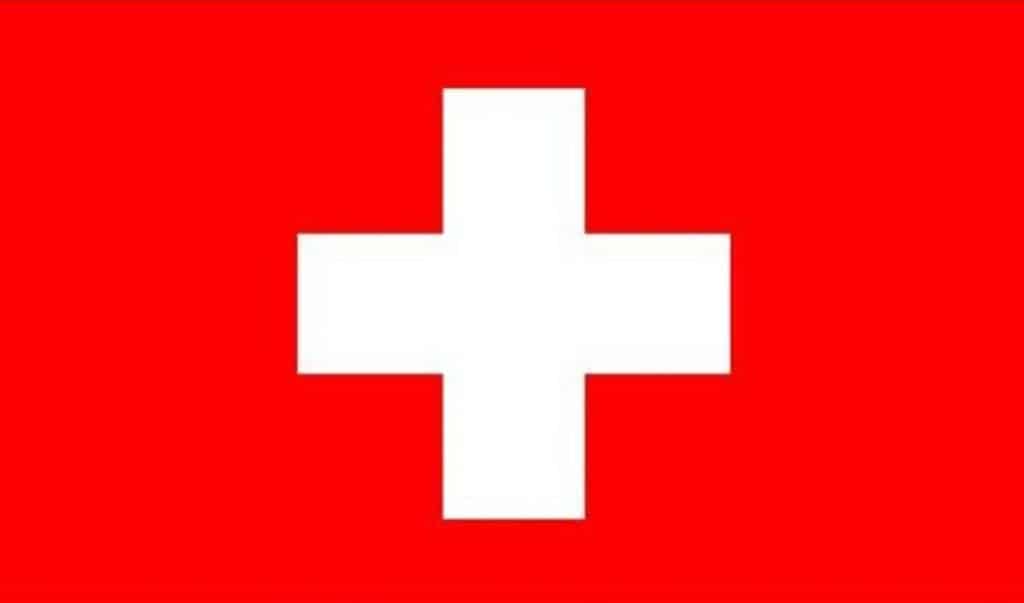
Genève conclut sa « trilogie Tudor » avec Roberto Devereux. Dans le rôle-titre, la soprano franco-danoise Elsa Dreisig.
C’est inconcevable mais pourtant véridique : pour l’Opéra de Paris, l’œuvre de Donizetti, riche de quelque 550 opus (dont 71 opéras), se résume à quatre titres dont un seul opera seria : Lucia di Lamermoor. Pendant ce temps, le Grand Théâtre de Genève parachève sa « Trilogie Tudor » en proposant ce mois-ci Roberto Devereux, après Anna Bolena (en 2021) et Maria Stuarda (en 2022). En ce mois de juin, il est d’ailleurs possible d’assister à l’intégralité de cette trilogie, avec une équipe vocale qui se retrouve en grande partie d’un titre à l’autre (pour plus d’informations, voyez ici).
On retrouve dans ce dernier volet, mis en scène comme les précédents par Mariame Clément, les aspects visuels et scéniques qui caractérisaient les deux premiers opus : des costumes qui mêlent différentes époques (le XVIe siècle et l’époque contemporaine) ; une scénographie (signée, comme les costumes, Julia Hansen) élégante, sobre, qui permet des changements de décors fluides et efficaces ; l’apparition sur scène de personnages présentés à différents moments de leur vie, etc. Le jeu d’acteurs est de toute évidence très travaillé, notamment dans quelques scènes-clés (le duo entre Sara et Nottingham). Pourtant, alors que cet opéra présente une efficacité dramatique exceptionnelle (elle y est infiniment supérieure que dans Anna Bolena et Maria Stuarda), il aura manqué au spectacle une véritable tension – celle qui, par exemple, dans la vision de Christof Loy à Munich, transformait l’œuvre en un véritable thriller. Et à force de sobriété, la scène finale, l’une des plus géniales jamais composées par Donizetti, ne procure pas tout à fait le frisson attendu…
On sait un gré infini au chef Stefano Montanari de respecter l’écriture donizettienne dans toutes ses nuances et sa richesse, sans « raccourcir » les codas, sans amputer l’œuvre des reprises prévues par le compositeur – comme le font quasi systématiquement toutes les salles parisiennes dès lors qu’elles programment une œuvre belcantiste. L’orchestre sonne de façon évocatrice et poétique, le choix des tempi est toujours juste, l’attention aux chanteurs constante. Tout au plus aurait-on pu souhaiter une trajectoire dramatique plus marquée, faisant avancer l’intrigue de façon plus efficace encore.
Vocalement, on apprécie le soin avec lequel les comprimari ont été distribués : au sein de cette équipe solide se distingue tout particulièrement le ténor Luca Bernard, aux interventions très assurées, le jeune chanteur semblant déjà prêt à assurer des emplois de plus grande envergure. Stéphanie d’Oustrac était en très belle voix en ce soir de première, et a brossé un portrait fort émouvant de la Duchesse Sara. En revanche on a connu Edgardo Rocha en meilleure forme vocale : pendant les deux premiers actes, les aigus sont tendus, et d’un registre à l’autre, l’émission vocale manque d’homogénéité. Mais après l’entracte, ces défauts s’atténuent ou disparaissent, ce qui permet au ténor de délivrer une émouvante scène de la prison. Nicola Alaimo remporte tous les suffrages dans le rôle de Nottingham. Convaincant dans les accès de violence du personnage, il l’est encore plus dans les moments cantabile, où le chanteur fait valoir un legato et une douceur dans le timbre de toute beauté. Stylistiquement, il est irréprochable (avec par exemple une reprise de la cabalette chantée à mi-voix et agrémentée de délicates variations).
Reste le cas d’Elsa Dreisig, très attendue dans le rôle-titre. Ce n’est pas faire injure au talent de la soprano franco-danoise que d’affirmer que sa voix n’est pas celle requise pour Elisabetta : le rôle demande un volume, une épaisseur, une projection que l’artiste ne possède pas. Mais Elsa Dreisig, dans l’éclectisme revendiqué qui la caractérise (elle chante aussi bien Elvira des Puritani, Salomé de Richard Strauss, Juliette de Gounod que des mélodies de Schumann ou Strohl !), fait souvent preuve d’une adaptabilité étonnante. Parvient-elle ici à transcender ses limites ? Se montre-t-elle convaincante dans ce redoutable rôle-titre, où s’illustrèrent entre autres artistes, Leyla Gencer, Montserrat Caballé, ou tout récemment Sondra Radvanovsky ? En partie seulement. La voix sonne claire, fraiche, pour tout dire, trop juvénile pour ce rôle d’une femme déjà vieillissante. La chanteuse compense certes une relative ténuité vocale par un vrai sens de la déclamation et une grande implication scénique. Malgré tout, le format vocal reste trop léger pour rendre pleinement justice aux imprécations et autres accès de fureur de la reine (« Va’ ; la morte sul capo ti pende ! ») ou au récitatif particulièrement dramatique précédent l’air final. Une belle performance néanmoins, très applaudie par le public genevois.
Une soirée inégale, donc, mais impossible pour un spectateur français en manque de Donizetti serio de bouder son plaisir !
Roberto Devereux, Comte d’Essex : Edgardo Rocha
Elisabetta, Reine d’Angleterre : Elsa Dreisig
Sara, Duchesse de Nottingham : Stéphanie d’Oustrac
Lord Duc de Nottingham : Nicola Alaimo
Lord Cecil : Luca Bernard
Sir Gualtiero Raleigh : William Meinert
Un page : Ena Pongrac
Orchestre de la Suisse Romande, dir. Stefano Montanari
Chœur du Grand Théâtre de Genève, dir. Mark Biggins
Mise en scène : Mariame Clément
Scénographie / Costumes : Julia Hansen
Lumières : Ulrik Gad
Dramaturgie et vidéo : Clara Pons
Roberto Devereux
Tragédie lyrique en 3 actes de Gaetano Donizetti, livret de Salvatore Cammarano, créé le 29 octobre 1837 au Teatro San Carlo de Naples.
Grand Théâtre de Genève, représentation du vendredi 31 mai 2024.








