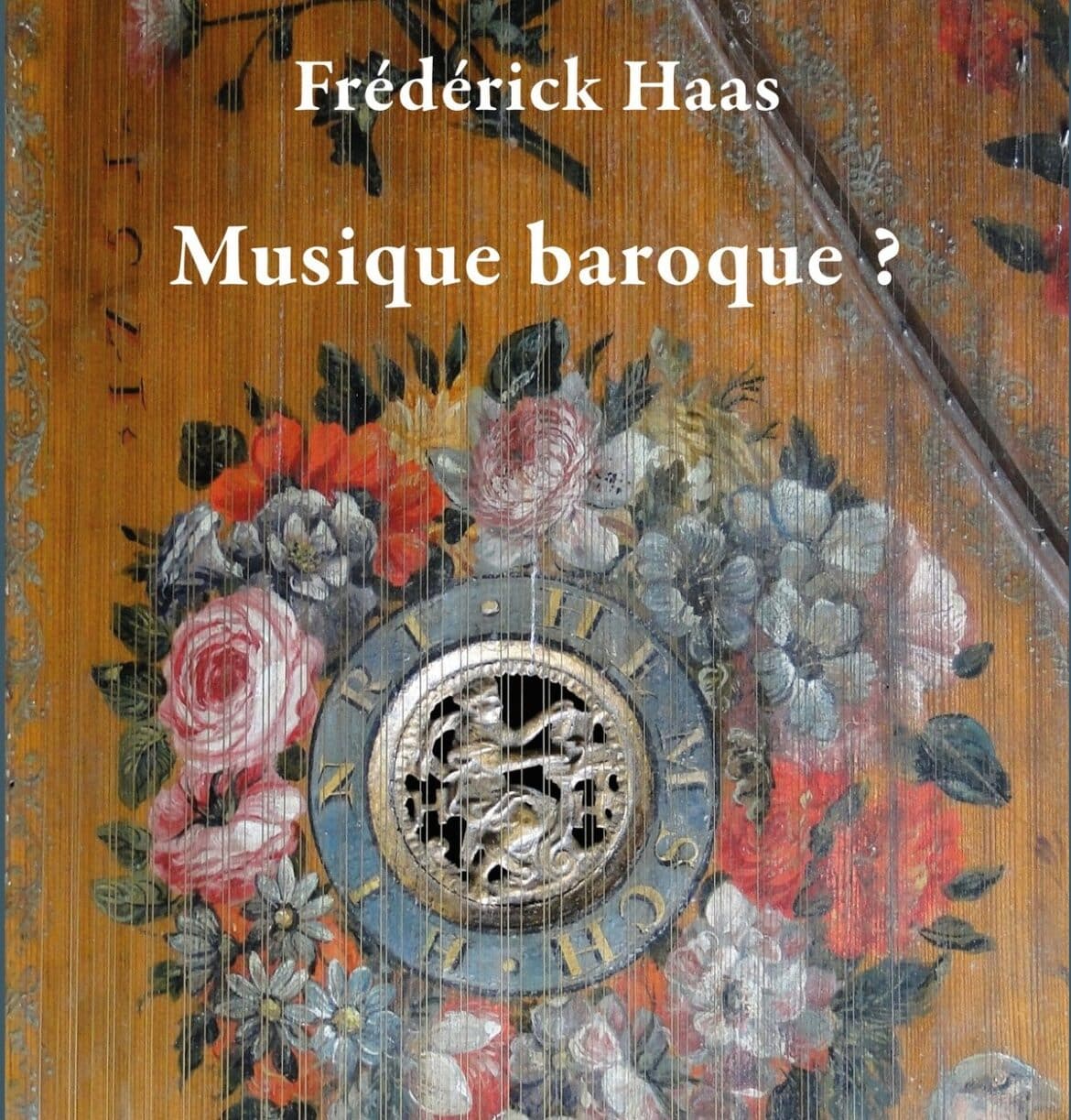« L’acte de faire la musique favorise aussi bien la connaissance que l’épanouissement de formes d’intelligence profondément humaines. Il contribue à en fonder l’identité aussi bien que la puissance (…) ». Voilà une phrase qui résume et explique ce livre foisonnant et hors normes de Frédérick Haas. Ce claveciniste chevronné et passionné exprime à travers son ouvrage Musique baroque ?, paru récemment aux éditions des Belles Lettres, toutes les tonalités d’un mouvement musical bigarré, protéiforme, qui a connu son âge d’or entre le XVIIe et le XVIIIe siècle et qui suscite un engouement sans cesse renouvelé.
Au-delà d’une définition de la musique baroque, cet ouvrage nous invite à penser la vie depuis la perspective d’un esprit baroque, au tempérament[i] musical empreint des textes des penseurs du Grand Siècle, du Siècle des Lumières et influencé par les spiritualités orientales. La musique elle-même est redéfinie comme ferveur, liberté, audace et devient objet d’amour et de fascination. Elle est moyen d’expression et fin en soi. Car bien qu’il s’agisse de musique ancienne, la musique est et restera toujours un art du présent.2 [ii]
Cet ouvrage inclassable interroge notre rapport au corps et nos usages du corps. Jouer du clavecin, c’est comme exercer un art martial, trouver le point d’équilibre entre souplesse et tension. Il faut se maîtriser, se libérer, se connaître, exercer ses muscles profonds, qui travaillent dans l’obscurité de la conscience et se départir des tensions accumulées par les muscles de la volonté, ceux-là que nous voyons, qui gonflent et qui font beaucoup de bruit pour rien. Cet ouvrage permet également de comprendre la musique depuis une perspective holiste qui, non sans désarçonner, remet en question notre rapport au temps, à l’usage de la technique, dans un monde post-industriel devenu mécaniste, étranger et réprobateur quant aux élans spontanés et naturels qui nous meuvent, quant aux mouvements de l’âme.
Ce livre est un livre de philosophie pratique qui se place depuis la perspective de la musique baroque. Il s’agit de rechercher l’harmonie dans sa vie comme dans son jeu pour atteindre une certaine plénitude. Cette harmonie ne peut être trouvée que dans l’équilibre fragile, l’accord issu de la tension entre une structure rythmique régulière, ordonnée et un usage des ornements et des mélopées irrégulier, échappant à toute nomenclature préalablement établie. Dans cette harmonie réside la clef de la définition du baroque.
Des réflexions personnelles, des anecdotes saillantes, la genèse d’une passion pour le baroque et des idées phares parsèment le livre : nos facultés déterminent nos goûts et nos désirs. Par ailleurs, une réelle défense et illustration de la grande musique se fait le miroir d’une critique acerbe de la modernité où la liberté de jeu, la spontanéité de l’instant, l’improvisation fille du risque sont balayés par le formatage, le conformisme et les attendus technicistes d’une société de la rentabilité plus que de la qualité.
La musique baroque est quelquefois qualifiée de musique ancienne, cette dénomination invite à se réinterroger sur le rôle de l’Histoire, la patine qu’elle donne au passé, ses gloires et ses impostures.
A travers ce livre consacré à la musique baroque l’on comprend le rôle thérapeutique de l’art et l’on vise sa dimension eschatologique. En effet, « l’art, en nous déplaçant par-delà les bruissements contingents du monde, nous nettoie [des] turpitudes ». Ce nettoyage que permet la musique, ce soin qu’elle confère, cette guérison qu’elle permet n’est pas pure rhétorique, ni abstraction. Lorsque l’on considère la musique d’un point de vue matérialiste, elle apparaît comme émission de vibrations sonores qui massent notre esprit et les pores de notre peau. Elle permet ainsi, de manière subtile de faire circuler l’énergie en nous, de nous stimuler, de nous rappeler à chaque instant avec raffinement, le mouvement de la vie. Le concept d’énergie, qui revient tel un leitmotiv dans l’ouvrage met en relief les influences de la psychanalyse jungienne dans la conception de l’auteur de la musique baroque.
La conclusion, véritable péroraison de l’ouvrage épidictique nous apprend que seul l’art peut sauver le monde. Phrase consensuelle et convenue s’il n’y avait pas eu tout l’ouvrage pour en appuyer les fondements et en révéler les ressorts. En effet, il s’agit de prendre conscience des potentialités de l’art et de sa dimension eschatologique : « il paraît évident que seul l’art peut sauver le monde : l’art en tant que manifestation de l’intelligence humaine, qui ne peut se manifester que dans les conditions essentielles d’éveil et de liberté. Il y a urgence à valoriser, à investir, à faire vivre, et qui sait à glorifier, à préserver du moins la valeur chaleureuse et mouvante qui fait la supériorité irréfragable de l’homme sur la machine. C’est cela même que la musique affirme, au cours d’une inextinguible et sublime jonglerie inscrite dans le temps sur quoi aucune volonté n’a prise ».
L’ouvrage, érudit, est écrit dans un style foisonnant, poétique, qui dépasse le cadre de son objet pour en souligner les perspectives et marquer son importance. La dernière phrase qui clôt l’ouvrage rappelle la formule de Berlioz qui considérait que l’amour et la musique étaient les deux ailes de la vie : « Par [la musique], nous pourrons apprendre à accueillir l’imprévu de la vie qui surgit, et à aimer par-delà nos solitudes le battement de l’humanité qui nous accueille sans bruit. Et nous apprendrons aussi à goûter, avec une sorte de joie, à la douceur flamboyante et mélancolique du temps qui s’écoule ». Le temps, voilà justement l’espace où la musique se déploie et nous permet, mieux que n’importe quel ouvrage de développement personnel à la mode, de nous recentrer sur nous-mêmes, de se retrouver.
Or, se connaître et se trouver est pour l’homme, « insatiable nomade », une gageure à laquelle il peut consacrer sa vie. Aussi, l’ouvrage de F. Haas aborde la psychologie, la philosophie sous l’angle de notre capacité à faire de la musique. Tous les concepts fondamentaux sont redéfinis, sans dogmatisme ni affèterie, mais avec une démarche de réflexion authentique. Celui qui est doté qu’un talent particulier, exprime par ses aptitudes un désir. « Le désir est la force de nous diriger inexorablement dans une direction dont nous n’avons pas même idée, pour trouver quelque chose qui sera peut-être comme le centre de nous-mêmes, et notre être paraîtra y trouver un sens, à la recherche de sa plénitude ».
Émaillé d’abondantes références qui nous donnent non seulement à entendre mais encore à penser à la manière des Anciens, Frédérick Haas, cite le plus souvent Rameau, Le Code de la Musique pratique, (1760) dont il épouse la conviction, exposée dans les Nouvelles réflexions sur le Principe sonore, selon laquelle au sein de la musique se trouve « la clef de tous les mystères de l’Univers ».
Frédéric Haas, Musique baroque ?, Belles Lettres, mars 2025
—————————————————————————-
[i] La notion même de tempérament est polysémique puisqu’elle désigne, en musique, la manière de diviser l’octave en douze sons.
[ii] Voir la conception des arts du temps décrite par Souriau.