Genève : ouverture de saison avec La Juive d'Halévy
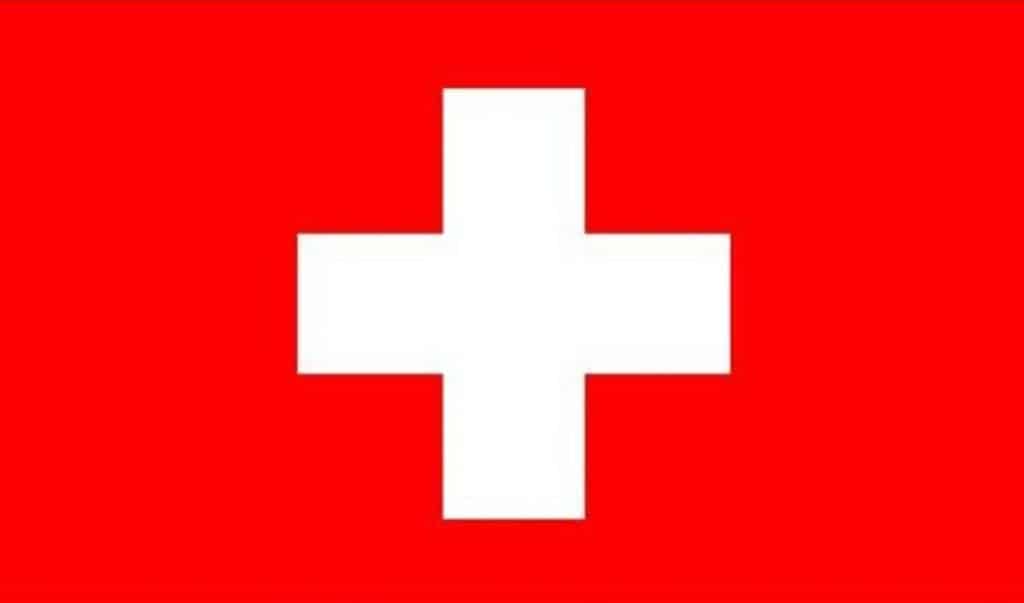
Un spectacle cohérent mais qui n’a guère convaincu le public…
Le fanatisme religieux, l’intolérance à l’égard de ceux qui ont des croyances différentes : des problèmes du passé, alors qu’un juif risquait la peine de mort pour avoir travaillé le dimanche, jour de repos des chrétiens ? Rien n’est moins sûr lorsqu’on lit qu’une jeune fille dans l’Iran des ayatollahs a été arrêtée pour avoir porté le voile d’une façon inappropriée, et est morte lors de sa garde à vue : nous découvrons, une fois de plus, que les événements absurdes et violents que nous voyons représentés au théâtre sont souvent d’une atroce actualité. Le metteur en scène américain David Alden a donc raison de transposer l’histoire de La Juive du XVe siècle, comme l’a racontée Eugène Scribe et l’a mise en musique Jacques-François-Fromental-Élie Halévy, dans une époque plus proche de la nôtre. C’est ce spectacle qui ouvre la nouvelle saison lyrique du Grand Théâtre de Genève.
Grand opéra à la française
Compositeur prolifique – son catalogue compte près de quarante œuvres composées entre 1820 et 1856, la dernière étant Noé laissée inachevée à sa mort en 1862 et terminée par son gendre Georges Bizet – Halévy est né en 1799 dans une famille juive de Bavière qui s’était installée en France à la suite de l’émancipation des Juifs après la Révolution française. L’attention qu’il porta à la culture juive se retrouve non seulement dans cette œuvre de 1835, mais aussi dans Le Juif errant (1852) et dans ses compositions de musique sacrée pour la synagogue. Musicien accompli, il avait suscité l’admiration de Wagner, malgré les sentiments antisémites que le compositeur de Leipzig avait exprimés plus tôt à l’égard de Meyerbeer et de Mendelssohn. Le livret de La Juive avait d’ailleurs au préalable été proposé à Meyerbeer – entre autres -, mais il l’avait refusé.
La Juive est le prototype du grand opéra, un genre purement français caractérisé par le choix d’un sujet comportant un arrière-plan historique et de forts contrastes passionnels, un découpage spectaculaire des scènes, l’utilisation d’un grand orchestre, la présence de chœurs importants, de ballets, et une longueur considérable, l’œuvre étant divisée en quatre ou cinq actes. C’est un genre dont la présence se renforça sur la scène parisienne après le grand succès de La Muette de Portici d’Auber en 1828, de Guillaume Tell de Rossini (1829) et de Robert le diable de Meyerbeer (1831). Si à Venise, au XVIIe siècle, le théâtre musical avait quitté les cours aristocratiques pour se confronter au public payant des théâtres publics, à Paris, avec le grand opéra, une autre révolution se produit : le théâtre devient une entreprise commerciale, un produit de consommation de masse, avec des spectacles colossaux destinés à la bourgeoisie qui peut ainsi afficher son nouveau rôle social et son pouvoir d’achat : d’où les décors grandioses, les personnages en nombre infini, les représentations sans fin, les ballets… et des danseuses, que le public masculin pouvait rencontrer après le spectacle. Alors qu’en Italie, les spectateurs mangeaient, buvaient, jouaient et faisaient l’amour dans les loges des théâtres, à Paris, l’opéra faisait office de « grand bordel » et le goût décoratif du Palais Garnier reflétera celui des luxueuses maisons de plaisir de la capitale française. C’est de l’une de ces maisons qu’est issue la maîtresse de Robert de Saint Loup, une prostituée juive que Marcel Proust avait baptisée Rachel-quand-du-seigneur…
Comme c’est souvent le cas dans les opéras, La Juive s’appuie également sur un antécédent qui est essentiel au développement de l’histoire que nous voyons se dérouler sur scène : bien des années auparavant, le juif Éléazar vivait en Italie et avait assisté à la condamnation et à l’exécution de ses enfants comme hérétiques par le comte romain de Brogni ; Éléazar lui-même avait été banni et contraint de fuir en Suisse. Au cours de son voyage, il avait trouvé une petite fille abandonnée dans une maison incendiée qui s’avéra être la maison de Brogni : des bandits y avaient mis le feu pendant que le comte était à Rome. Éléazar avait élevé l’enfant comme sa propre fille, la nommant Rachel, tandis que de Brogni était devenu prêtre, puis cardinal.
Nous sommes en 1414 à Constance, où un Concile a réaffirmé la suprématie de l’Église de Rome et condamné au bûcher l’hérétique Jan Hus, théologien et réformateur bohémien et premier précurseur de la Réforme protestante qui aura lieu un siècle plus tard. Les souvenirs de ces événements anciens reprennent vie lorsque l’orfèvre Éléazar risque la peine de mort pour avoir travaillé le dimanche et que seule l’intervention du cardinal de Brogni le sauve. Mais bientôt un autre problème met sa famille en danger : sa fille Rachel tombe amoureuse du jeune Samuel, en réalité le prince Léopold, un chrétien, et la loi de l’époque punit de mort l’union d’une juive avec un chrétien. Dans le finale, alors qu’une conversion pourrait sauver la vie de la jeune fille, elle refuse et monte sur le bûcher. C’est seulement maintenant qu’Éléazar peut répondre aux questions de Brogni à qui il avait avoué que Rachel était la fille qu’il avait sauvée de l’incendie : « Ma fille existe-t-elle encore ? Où donc est elle ? » « La voilà ! » s’exclame Éléazar en désignant les flammes du bûcher.
Un John Osborn au mieux de sa forme
Titre peu présent dans les programmes des théâtres, La Juive est d’ailleurs à peu près le seul opéra qui soit encore joué parmi les œuvres d’Halévy. Sa création à Paris le 23 février 1835 a eu lieu à l’Académie Royale de Musique (Salle Le Peletier) un mois après I puritani de Bellini (24 janvier, Théâtre-Italien) et on y retrouve le même goût pour le bel canto et la mélodie. On relève d’ailleurs plusieurs fois des traits italiens dans cette œuvre : dans la cavatine de Brogni au premier acte, dans la sérénade de Léopold, toujours au premier acte, dans le boléro d’Eudoxie au troisième. Le rôle de père nécessiterait, traditionnellement, une voix plus grave et Halévy avait en fait initialement pensé à un baryton-basse pour Éléazar, mais le ténor Adolphe Nourrit avait insisté pour créer le rôle : c’était pour lui (comme pour le public) une forme de défi, celui consistant à créer un rôle qui mettrait en valeur son talent dramatique, après avoir été admiré jusqu’à ce moment de sa carrière pour ses acrobaties vocales dans les opéras de Rossini (dont Arnold dans Guillaume Tell, entre autres) et de Meyerbeer (Robert le diable, alors que Les Huguenots seront son plus grand mais aussi son dernier succès). Il faut donc ici un chanteur qui combine une technique vocale sûre avec une forte personnalité dramatique, et John Osborn, qui fait ses débuts dans le rôle, se montre en pleine possession de ces qualités. Son Éléazar n’a pas seulement le style, l’élégance et la maîtrise du phrasé qui l’ont toujours caractérisé : le ténor américain campe magistralement un personnage qui a la complexité du Shylock shakespearien lorsqu’il est partagé entre le désir de vengeance contre le comte de Brogni, qui a exterminé sa famille, et son amour pour Rachel, même si elle n’est pas vraiment sa fille.
La Juive est surtout connue pour l’air du quatrième acte « Rachel, quand du Seigneur », premier succès discographique mondial lorsqu’ Enrico Caruso l’enregistra en 1920. Nourrit avait demandé au librettiste Scribe de séquencer les mots d’une façon très précise afin d’en renforcer l’expressivité ; le résultat fut une aria se référant lointainement à une poignante mélodie juive chantée dans une synagogue. Cette page, dévolue à Osborn, donne au ténor l’occasion d’exprimer tout son potentiel dans les contrastes forts suggérés par les mots, où berceau rime avec bourreau. Dans cet air, on peut également admirer le raffinement orchestral dont fait preuve Halévy, avec les deux cors anglais sur le tapis de cordes pizzicato par lequel il commence. Mais l’aria elle-même fait partie d’une séquence longue et complexe, avec un chœur hors scène (dispositif démontrant le talent théâtral du compositeur) et, au contraire, la présence scénique assurée de l’interprète. La performance d’Osborn confirme une fois de plus l’idée que l’opéra aurait dû s’intituler de manière plus appropriée Le Juif, étant donné l’importance du personnage.
Une excellente distribution
Un autre ténor est aussi l’un des deux antagonistes d’Éléazar – le troisième étant de Brogni, une basse – : Ioan Hotea est un jeune Roumain au généreux instrument vocal caractérisé par un beau timbre et des aigus brillants, bien qu’un peu tirés. Ce personnage ingrat du prince Léopold, qui se fait passer pour le juif Samuel afin de pouvoir fréquenter la maison d’Éléazar et de sa fille Rachel – à la fin, il sera sauvé parce qu’il est riche et noble – est porté vocalement par une technique vocale sûre qui convainc le public. Et ce même public ne peut qu’admirer l’excellence de la distribution employée ici, avec la basse russe Dmitrij Ul’ianov, un excellent de Brogni disposant d’un superbe registre grave magnifiquement porté par le souffle, ou avec le baryton Leon Košavić, un jeune chanteur croate affirmant une présence sûre dans les rôles de Ruggiero, d’Albert et du Bourreau.
Il a été annoncé avant la représentation que les deux interprètes féminines étaient en légère méforme, mais honnêtement, il fut bien difficile de trouver des faiblesses dans les performances des deux chanteuses, lesquelles se sont partagé équitablement les chaleureux applaudissements. La soprano arménienne Ruzan Mantashyan, déjà été admirée dans le rôle de Nataša dans Guerre et Paix de Prokofiev à Genève l’année dernière, réussit à définir avec sensibilité un personnage continuellement déchiré entre les élans amoureux, le désespoir et les pensées mortifères. Même si Rachel intervient essentiellement au cours de duos avec Samuel/Léopold, son père ou la princesse, Mantashyan parvient à attirer l’attention grâce à sa grande personnalité. Une grande personnalité dont dispose également Elena Tsallagova, qui donne vie de manière éclatante au personnage assez superficiel de la princesse Eudoxie, celle à qui Halévy confie les agilités vocales que la soprano russe aborde et résout avec une facilité surprenante en rendant empathique un personnage qui, sur le papier, ne l’est certainement pas…
Une direction et une mise en scène qui n’ont pas pleinement convaincu
Sur le podium de l’Orchestre de la Suisse Romande, Marc Minkowski apporte son expérience du répertoire français et offre une Juive musicalement moins « grand opéra » que ce que le public attendait, et certains ont été déçus – mais aussi par la mise en scène : où étaient donc passés les six cents acteurs et les vingt chevaux de la première parisienne ?… Minkowski privilégie la transparence de l’écriture orchestrale et souligne avec ironie les moments un peu klezmer d’une musique qui, au sein de cette tragédie, présente des oasis de vivacité presque offenbachienne : « Des ducats, des ducats, des florins, | quel plaisir de tromper ces chrétiens » chante joyeusement Éléazar après avoir vendu à la princesse, pour trente mille ducats, une chaîne en or à laquelle est attachée une relique. Minkowski connaît bien ce genre, l’ayant souvent fréquenté et avec des résultats admirables…
L’immense partition a été réduite de manière appropriée aux capacités d’écoute du public d’aujourd’hui, soit trois heures complètes de musique, en éliminant les ballets, les pantomimes et certaines pages insignifiantes, mais en maintenant l’intégrité de celles qui sont restées. Son choix a été gagnant : les moments les plus dramatiques et les plus spectaculaires ont ainsi été mis en avant, ce que la mise en scène de David Alden a souligné en mettant en scène l’abus d’une religion sur une autre. En effet, à l’ouverture du rideau, nous voyons les Juifs errer craintivement sous la menace des matraques de personnages lugubres tandis que le chœur des chrétiens chante les louanges de leur seigneur depuis une église d’où se distingue un énorme orgue. Toujours avec des Bibles à la main, les bourgeois menacent les Juifs qui sont humiliés – le carrosse du Cardinal puis celui de l’Empereur sont tirés non par des chevaux mais par un Juif pieds nus – et soumis à des abus et des lois absurdes. La rafle des Juifs avec leurs maigres valises rappelle d’autres images terribles du siècle dernier, et le bûcher du finale est réalisé par un couloir de tôles ondulées menant à des fours dont nous apercevons les sinistres lueurs. Le costumier Jon Morrell habille les chrétiens avec des vêtements du XIXe siècle, ceux de l’époque de la composition, tandis que pour les juifs, il opte pour l’entre-deux-guerres. Les traits grotesquement caricaturaux des bourgeois de Constance, les ombres et lumières rasantes de D.M. Wood donnent un côté expressionniste aux visuels, de même que la scénographie efficace de Gideon Davey. Alden règle parfaitement le jeu scénique des interprètes individuels, mais il fait preuve également d’une grande maîtrise dans le déplacement des masses sur scène, le chœur du théâtre étant par ailleurs superbement dirigé par Alan Woodbridge.
Le résultat est un spectacle cohérent, mais qui n’a pas pleinement convaincu le public genevois, lequel, il est vrai, n’a pas afflué en masse dans son théâtre, de nombreux sièges étant restés vides. Le discrédit dont souffre le grand opéra n’a donc pas été totalement effacé… à moins que les raisons de cette désaffection ne soient tout autres : peut-être le public s’attendait-il en fait à quelque chose de plus grandiose ? Il aura cependant une nouvelle opportunité de se familiariser avec ce genre, le programme de l’an prochain devant comporter un autre titre de ce genre… mais il encore trop tôt pour en parler !
Rachel Ruzan Mantashyan
Le Juif Eléazar John Osborn
Léopold Ioan Hotea
La Princesse Eudoxie Elena Tsallagova
Le Cardinal de Brogni Dmitry Ulyanov
Ruggiero / Albert Leon Košavić
Orchestre de la Suisse Romande, Chœur du Grand Théâtre de Genève, dir. Marc Minkowski
Mise en scène David Alden
Scénographie Gideon Davey
Costumes Jon Morrell
Lumières D.M. Wood
Mouvement Maxine Braham
Coproduction avec le Teatro Real de Madrid
La Juive
Opéra en cinq actes de Fromental Halévy sur un livret original d’Eugène Scribe, créé à l’Académie royale de musique (salle Le Peletier) le
Grand Théâtre de Genève, représentation du 17 septembre 2022.








