Katia, dans le plus simple appareil

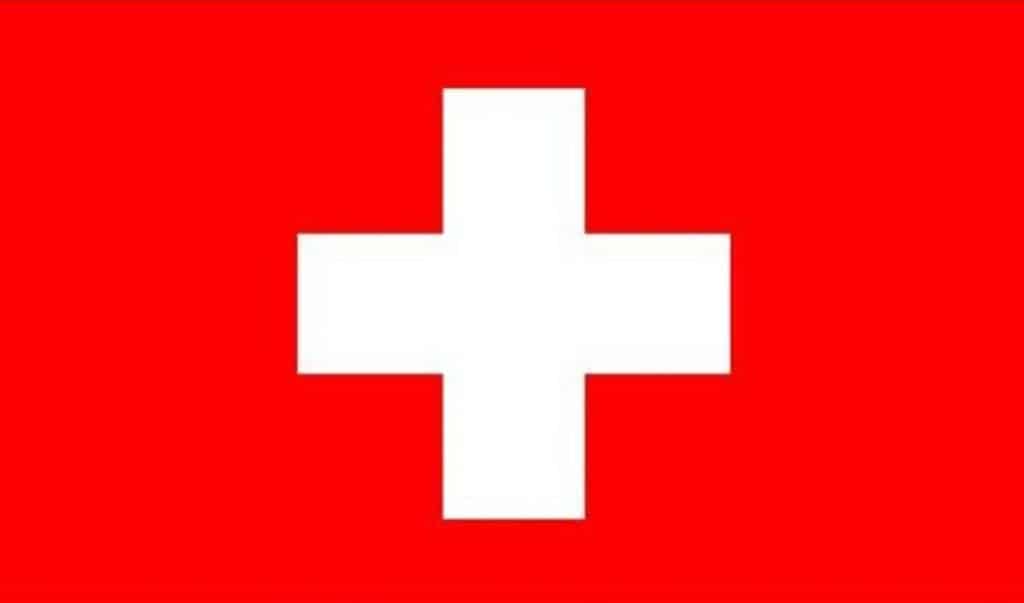
À Genève, un Janáček dépouillé et vibrant servi par une soprano en état de grâce
À une époque où pousser les portes d’une salle d’opéra peut se révéler tellement anxiogène que certaines directions se sentent obligées de mettre en garde leur public (comme pour la Salomé kitscho-tarantinesque de Lydia Steier qui repeint en ce moment les murs de Bastille au foutre et à l’hémoglobine), le Grand Théâtre de Genève a osé l’impensable : une production qui prend le contre-pied de la surenchère scénique, oublie les écrans vidéos, les machines à coudre, les piercings de tétons et les carcasses de bidoche pour se mettre humblement au service de la musique et du drame. Posture audacieuse, voire radicale, d’autant plus remarquable qu’elle s’applique à un opéra où le sexe, la mort, la frustration et l’amour dansent une macabre sarabande – autant de prétextes qui auraient pu justifier l’une de ces mises en scène à l’expressionnisme caricatural dont l’opéra du XXe siècle (et des siècles précédents) fait si souvent les frais…
Et pourtant : pour dépeindre les tourments spirituels et sensuels qui mèneront au suicide la jeune Katia Kabanová, mal mariée au bourru Tikhon, malmenée par sa rude marâtre la Kabanicha et mal aimée par le fade Boris, la metteuse en scène berlinoise Tatjana Gürbaca a choisi de recourir à un décor minimaliste. Une sorte de boîte en bois clair, évidée sur ses trois côtés pour dessiner autant de cadres qu’animent et caressent des lumières pastel ou nocturnes, espace physique autant que mental dans lequel viennent s’inscrire des chanteuses et chanteurs dirigés avec une sensibilité et une intelligence rafraîchissantes.
Pour délicat qu’il soit, le travail d’équilibriste de Gürbaca et de son équipe artistique ne s’enlise jamais dans la mièvrerie. La violence intrinsèque de l’œuvre s’exprime d’autant mieux par contraste, à travers le chant et la gestuelle heurtée des personnages rustres du drame – la belle-mère incarnée par Elena Zhidkova, figée dans sa tenue amidonnée, aussi rigide que les préceptes par lesquels elle entend régir la vie de son fils et de sa bru; l’oncle Dikoj, auquel Tómas Tómasson confère une brutalité aussi animale qu’éthylique; et l’inquiétant Tikhon de Magnus Vigilius, poisseux de couardise. Les autres personnages du récit sont de braves villageois se débattant avec leurs désirs et leurs regrets, tentant de vivre sous le joug de lois morales, religieuses ou sociales dont ils s’accommodent plus ou moins bien. C’est là tout le dilemme de Katia, créature élémentaire d’une ferveur religieuse naïve mais d’une irrépressible vitalité sensuelle, qui s’épanche autant dans la contemplation de la nature que dans l’espoir d’éprouver un jour l’amour pour un autre homme que son terne mari. La soprano américaine Corinne Winters, rompue à l’esthétique janacekienne (elle était Jenůfa à Genève la saison dernière et a incarné Katia Kabanová pour la première fois cet été à Salzbourg) trouve pour donner vie à cette Bovary de la Volga des accents d’une candeur presque enfantine, impression renforcée par sa silhouette gracile – et comme dissonante, à mesure que s’épaissit le drame. Face à elle, la mezzo croate Ena Pongrac incarne avec un naturel mutin sa confidente Varvara. Double lumineux de Katia, elle est celle par qui « l’orage » métaphorique se déclenchera puisque c’est elle qui jette son amie dans les bras de Boris. Aleš Briscein campe cet amant falot avec une belle ambiguïté, comme s’il était lui-même écrasé par la force du sentiment qui l’habite et incapable de s’en saisir, ses déclarations d’amour sonnant comme des plainte angoissées. La grande scène nocturne de l’Acte II, baignée d’une ineffable tendresse, illustre cette double vision de l’amour : joueur et complice entre Varvara et l’instituteur Kudrjaš, auquel Sam Furness prête un bel aplomb vocal ; vibrant mais hésitant entre Katia et Boris, relégués en fond de scène dans une sorte de cadre oscillant, balançoire instable où se frôlent les deux amants aux timides étreintes.
Lorsque, à l’orée du dernier acte, un orage bien réel éclate, c’est comme à son diapason que Katia surgit parmi la foule des villageois et, rongée de culpabilité, annonce à la foule son adultère avec Boris. Le chœur – étonnamment discret, pour un opéra de Janáček – se mue alors en foule haineuse, crachant son mépris sur l’infortunée. Un étrange ballet s’ensuit, magnifique inspiration de Tatjana Gürbaca : quelques jours après son aveu, devenue femme adultère battue par son mari, Katia retrouve Boris pour d’ultimes adieux – lui va être envoyé en Sibérie par son oncle, elle a déjà pris la décision de mettre fin à ses jours. Tandis que les deux amants, occupant cette fois l’avant-scène, échangent leurs dernières paroles et que Katia répète, comme un triste refrain, « je voulais te dire quelque chose », les personnages du drame apparaissent derrière eux et, chacun dans son coin, effectuent une série d’actions énigmatiques, répétées en boucle dans une logique de rêve : la Kabanicha se regarde dans un miroir tendu par sa domestique, Dikoj manque s’étouffer en mangeant une pomme, Tikhon refait à l’infini son nœud de cravate pendant que Varvara cire ses chaussures, une petite fille lance en l’air son ballon rouge… Il y a, dans ce manège temporel tragi-comique, quelque chose de l’inquiétante étrangeté du Tango de Zbigniew Rybczyński (court-métrage polonais de 1981). Comme si ne restait de la vie terrestre, si ingrate à Katia, qu’un simulacre absurde, dont la délivreront bientôt les flots glacés de la Volga…
On sait depuis Ernest Ansermet, grand défenseur de la musique de Bohuslav Martinů, qu’un peu de sang tchèque coule dans les veines de l’Orchestre de la Suisse romande. Ses musiciens sont à l’unisson de la réussite scénique et vocale de cette soirée, emmenés par un Tomáš Netopil qui sait les faire chanter dans son arbre généalogique (et dont la dernière incursion janáčekienne remontait à deux ans avec L’Affaire Makropoulos, déjà sur cette même scène).
Grâces soient rendues à cette production, qui prouve qu’une mise en scène d’opéra peut se passer d’être (faussement) disruptive et (puérilement) épate-bourgeois. Il suffit, parfois, de faire entendre l’œuvre dans son plus simple appareil.
Katěrina Kabanová : Corinne Winters
Boris Grigorjevič : Aleš Briscein
Marfa Ignatěvna Kabanová (Kabanicha) : Elena Zhidkova
Tikhon Ivanyč Kabanov : Magnus Vigilius
Savël Prokofjevič Dikój : Tómas Tómasson
Váňa Kudrjaš : Sam Furness
Varvara : Ena Pongrac
Kuligin : Vladimir Kazako
Feklouša : Natalia Ruda
Glaša : Mi-Young Kim
Chœur du Grand Théâtre de Genève, direction Alan Woodbridge
Orchestre de la Suisse Romande, direction Tomáš Netopil
Mise en scène : Tatjana Gürbaca
Scénographie : Henrik Ahr
Costumes : Barbara Drosihn
Lumières : Stefan Bolliger
Dramaturgie : Bettina Auer
Katia Kabanová (1921)
Leoš Janáček (1854-1928)
Opéra en 3 actes. Livret de Vincenc Červinka d’après L’Orage d’Alexandre Ostrovski (1859). Édition révisée de l’opéra par Sir Charles Mackerras et Karl Heinz Füssl.
Création le 23 novembre 1921 au Théâtre de Brno
Coproduction du Grand Théâtre de Genève et de la Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf Duisburg