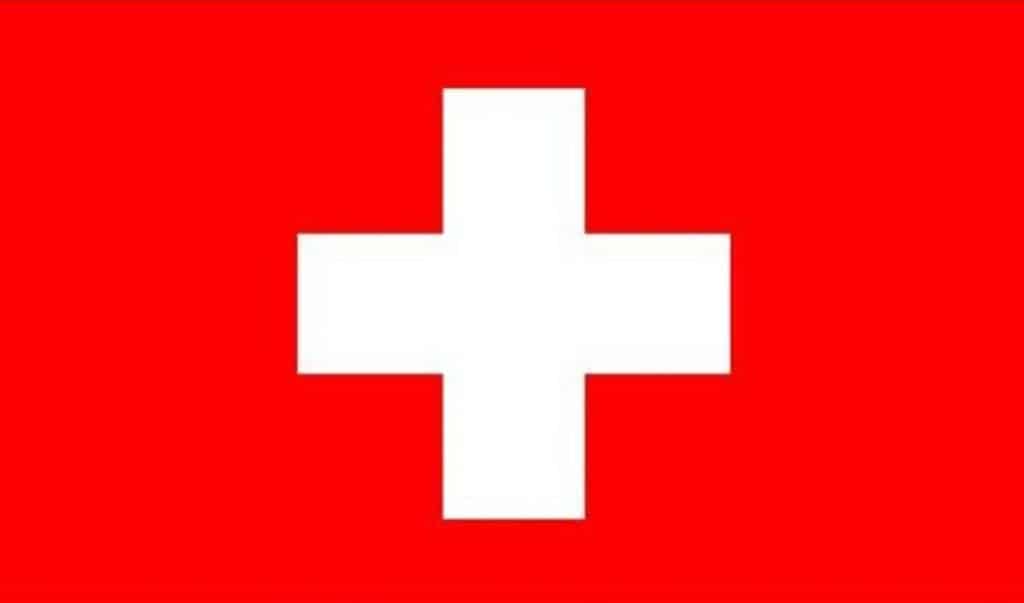
Le réalisateur Kornél Mundruczó situe sa Salome dans un hôtel chic new-yorkais, et centre sa vision de l’œuvre sur les relations toxiques entre les personnages : une lecture qui convainc le public, portée par une interprétation musicale de qualité.
Après Le Château de Barbe-Bleue ou L’Affaire Makropoulos, Kornél Mundruczó revient à l’opéra avec Salome. Sensualité, sexualité, relations familiales tendues voire toxiques : a priori, le chef-d’œuvre de Richard Strauss correspond bien à la sensibilité et aux préoccupations ou obsessions du réalisateur hongrois – et l’accueil chaleureux réservé au spectacle à l’issue de cette deuxième représentation au Grand Théâtre de Genève semble le confirmer.
Il n’y a bien sûr, dans cette relecture, ni Judée, ni tétrarque, ni tensions religieuses autour de la venue annoncée du Messie. L’histoire est transposée dans un hôtel chic new-yorkais : nous sommes entre gens de la haute société, et la mise en scène de Kornél Mundruczó donne surtout à voir la violence et l’amoralité de leurs relations, uniquement régies par leur quête de l’argent et du pouvoir (pouvoir social en tant que domination d’une caste, celle des gens aisés, sur les gens modestes ; pouvoir psychologique, Salomé, Hérode et Hérodias essayant tous à leur façon de manipuler telle ou telle personne en utilisant leurs failles, leurs fragilités).
Une direction d’acteurs travaillée, mais aussi le fait d’avoir fait de Jochanaan un marginal aux propos particulièrement dérangeants dans cet univers capitaliste aux règles intangibles rendent le propos convaincant. Le spectacle offre par ailleurs quelques tableaux particulièrement forts : le suicide de Narraboth, la danse des sept voiles, fort bien interprétée par Olesya Golovneva, la scène finale, avec l’immense tête de Jochanaan reposant sur le sol et de laquelle sortent (par les narines, les yeux, la bouche) divers avatars de Salomé ; ou encore le viol de Salomé par Hérode, et la scène où la princesse scalpe, littéralement, Jochanaan. Pour respecter la règle de la bienséance qui est celle du public du XXIe siècle, la scène du viol reste bien sûr invisible du public (seule une tache de sang sur le collant portée par la chanteuse en témoigne) ; mais la torture infligée à l’homme est exhibée longuement, minutieusement, à l’avant-scène.
Deux scènes certes choquantes, mais après tout, le but premier de Salome, un opéra donnant à voir le désir lubrique et incestueux d’un vieillard, la décapitation d’un homme, une jeune fille animée de pulsions nécrophiles, la mise à mort d’une femme broyée sous des boucliers, n’est-il pas avant tout de heurter, frontalement, le public ? C’est finalement moins le caractère choquant de ces scènes que leur signification qui, selon nous, pose question. Le texte d’Oscar Wilde est en effet l’un des rarissimes livrets d’opéras faisant des femmes non pas des victimes (Salomé est bel et bien mise à mort à la fin de l’œuvre, mais elle a auparavant, continûment, dominé les hommes, soit en les faisant chanter grâce à son pouvoir de séduction, soit en les faisant exécuter) mais des êtres de pouvoir : elles s’y font les égales des hommes jusque dans certains traits de caractère détestables (lubricité, insensibilité, goût du pouvoir, violence gratuite, incapacité à comprendre que « quand c’est non, c’est non ! ») que les librettistes d’ordinaire réservent exclusivement au sexe masculin. Or en faisant de la princesse de Judée la victime d’un viol (comme dans la récente mise en scène de Lydia Steier à Bastille), la décapitation de Jochanaan peut être perçue comme une forme de vengeance, non pas contre Jochanaan, « coupable » d’avoir refusé les avances insistantes et déplacées dans leur insistance de Salomé, mais contre les hommes en général, et se trouve presque, en quelque sorte, « justifiée ». Le geste terrible de la princesse perd ainsi selon nous beaucoup de sa force, laquelle réside précisément dans le mystère indéchiffrable d’une cruauté extrême et gratuite.
Musicalement, le succès est avant tout celui de l’orchestre de la Suisse romande, vraiment superbe de coloris, de précision, de dramatisme, et du chef Jukka-Pekka Saraste : obtenant des musiciens une pâte sonore d’une densité remarquable – sans que les détails de l’orchestration s’en trouvent pour autant écrasés, ni la projection vocale des chanteurs mise en difficulté –, il remporte aux saluts finals un grand succès amplement mérité.
C’est la première fois que nous entendions Olesya Golovneva : on lit dans le programme que la soprano a à son répertoire les rôles de Violetta, Lucia ou Konstanze, ce qui ne laisse pas de nous surprendre tant sa voix semble solidement ancrée dans le bas de la tessiture, avec un médium et un grave particulièrement fermes (superbe « Und das Geheimnis der Liebe ist grösser als das Geheimnis des Todes » lors de la scène finale). De fait, la voix est ample, pulpeuse, projetée avec facilité si ce n’est dans quelques aigus, qui plafonnent parfois un peu ou flirtent avec la justesse (« nichts in der Welt ist so weiss wie dein Leib »). L’articulation se fait par ailleurs parfois un peu cotonneuse, insuffisamment incisive dans le haut du registre. Mais l’investissement vocal et physique de l’artiste force l’admiration, d’autant qu’il s’agit là d’une prise de rôle. Son Jochanaan est un admirable Gábor Bretz. Que ceux qui n’avaient pas été entièrement convaincus par son Don Quichotte à Bastille l’écoutent dans le répertoire allemand : il convient décidément remarquablement à ce baryton-basse hongrois, dont nous avions déjà apprécié le Wotan à la Monnaie de Bruxelles. La voix est longue, ample, l’accent noble et autoritaire comme il se doit dans les imprécations lancées contre la cour de Judée en général et Hérodias en particulier. Autour d’eux gravite une solide équipe de chanteurs : Hérode est campé par John Daszak dont la voix, claire et légèrement trompétante est, dans ce rôle, fidèle à une certaine tradition. Hérodiade (Tanja Ariane Baumgartner) en revanche surprend par la jeunesse de sa voix et de sa silhouette, renouvelant considérablement notre perception du personnage. Des seconds rôles se distinguent notamment l’émouvant Narraboth de Matthew Newlin, impeccable vocalement, et les excellents page d’Ena Pongrac, premier soldat de Mark Kurmanbayev et deuxième soldat de Nicolai Elsberg.
À la fin du spectacle, Salomé et ses doubles, face au public, écrivent au feutre sur leur corps un sibyllin « STOP » : stop aux violences faites aux femmes ? Aux décapitations d’hommes ? À la concupiscence des vieillards libidineux ? Aux mères dépourvues de morale ? À moins que ce mot ne signe tout simplement la fin de la représentation… mais pas du spectacle, qui se donnera au Grand Théâtre jusqu’au 2 février !
Salomé : Olesya Golovneva
Jochanaan : Gábor Bretz
Hérode : John Daszak
Herodias : Tanja Ariane Baumgartner
Narraboth : Matthew Newlin
Le page d’Herodias : Ena Pongrac
Premier soldat : Mark Kurmanbayev
Deuxième soldat : Nicolai Elsberg
Premier Juif : Michael J. Scott
Deuxième Juif : Alexander Kravets
Troisième Juif : Vincent Ordonneau
Quatrième Juif : Emanuel Tomljenović
Cinquième Juif : Mark Kurmanbayev
Premier Nazaréen : Nicolai Elsberg
Deuxième Nazaréen : Rémi Garin
Un cappadocien : Peter Baekeun Cho
Orchestre de la Suisse Romande, dir. Jukka-Pekka Saraste
Mise en scène : Kornél Mundruczó
Collaborateur à la mise en scène : Marcos Darbyshire
Scénographie et costumes : Monika Korpa
Lumières : Felice Ross
Dramaturgie : Kata Wéber
Chorégraphie : Csaba Molnár
Salome
Opéra en un acte de Richard Strauss, livret du compositeur, d’après la traduction allemande par Hedwig Lachmann de la pièce de théâtre Salomé d’Oscar Wilde, créé au au Königliches Opernhaus de Dresde le 9 décembre 1905.
Grand Théâtre de Genève, représentation du samedi 25 janvier 2025.







