LES INCLASSABLES : LA NUIT DES RATS MORTS
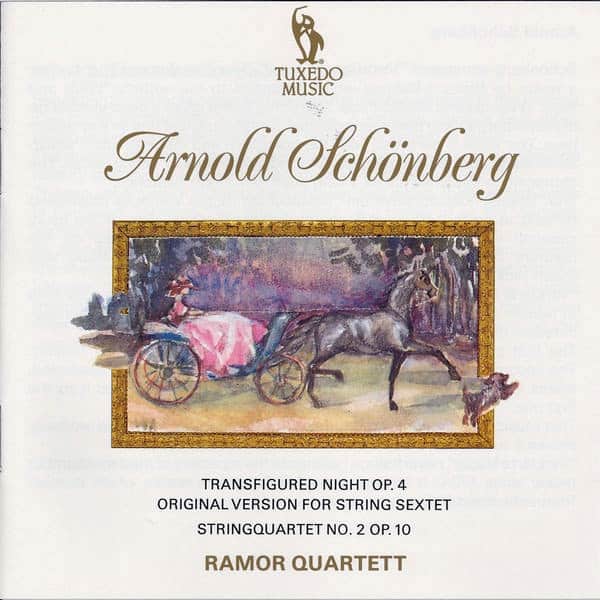
Arnold SCHÖNBERG, La Nuit transfigurée –
Version originale pour sextuor à cordes ;
Quatuor à cordes op.2 n°10 avec soprano
Ramor Quartet (Andreas Sándor, Erwin Ramor, violons I & II / Zoltan Thirring, alto / Vera Nogrady, violoncelle) + Zsolt Deaky, violoncelle / Edith Lorincz, violon / Marie-Thérèse Escribano, soprano
Arnold SCHÖNBERG
La Nuit transfigurée
Version originale pour sextuor à cordes
Quatuor à cordes op.2 n°10 avec soprano
1 CD Tuxedo (enr. 1961)
Les Inclassables, ou l’Enfer de nos discothèques
Nos discothèques ont toutes leur « enfer » où, dissimulés aux regards des mélomanes avertis dont nous craignons les quolibets, nous conservons les enregistrements qui nous font honte mais que nous chérissons malgré tout d’un amour irraisonné…
Ramor Quartet, kesaco ? Pour le mélomane novice que je suis, en cette année de mes quinze ans, cette question n’a à priori aucune importance. Je viens de passer la soirée à écumer les disquaires du Quartier Latin sans rien trouver de bien transcendant à me mettre sous l’oreille. C’est l’époque où le disque est cher, rien à moins de 135 francs, et Naxos n’a pas encore révolutionné la vie des musicophiles fauchés en inondant le marché de ses CD à 50 francs et de ses interprètes aux noms exotiques. Autrement dit, le passage par la case « occasion » est indispensable pour tout débutant désireux d’étoffer sa discothèque. Ultime station de ma passion mélomaniaque : un soldeur de la place Saint-Michel, pas exactement spécialiste de musique classique à en juger par sa façon de classer sous l’étiquette VERDI un Very Best of Adagios III et un Verona Arena Live : Tosca. Les bacs succèdent aux bacs, mes doigts s’empoussièrent et mon enthousiasme aussi. De dépit, je manque me rabattre sur une Inachevée de Schubert par l’incertain Ludovit Rajter à la tête du Slovak State Philharmonic, avant qu’un sigle honni au verso du boîtier m’en dissuade : AAD. (En ces temps-là, mon exigence musicale se bornait à 3 lettres synonymes de félicité sonique : D, D et D. Je pouvais à la rigueur condescendre à accueillir dans ma discothèque quelques enregistrements ADD, mais AAD ? I have my dignité.) La pile de disques à 3 francs (oui, oui, 0,45 euros) à côté de la caisse représente mon dernier espoir – maigre espoir en vérité, puisque le mauvais grain l’y dispute d’ordinaire à l’ivraie.
Mais pas ce soir-là.
Car voici qu’apparaît, entre Das Land des Lächelns – Höhepunkte et Les Plus Belles Pages de Maurice André, ce fameux disque Schönberg par un quatuor au nom de moutarde (ou de poudre anti-nuisibles). Label inconnu, musiciens idem, pochette d’une cul-cuterie peu engageante et assez peu conforme à l’idée que je me fais du révolutionnaire Viennois (promenade en tilbury d’une donzelle en robe rose froufroutante pendant que gambade son chihuahua, le tout évoquant un Constantin Guys de la place du Tertre). Seulement voilà, je cherche une initiation en douceur à la Seconde École de Vienne et cette Nuit transfigurée dont j’ai entendu quelques notes à la radio m’a tout l’air d’être le Sésame idéal. À ce prix-là, je ne risque pas grand-chose.
Et le risque paie.
Du moins à mes jeunes oreilles. Réécoutant cet enregistrement de 1961 dans une nuit parisienne transfigurée par le coronavirus, je peux difficilement faire l’impasse sur ses loupés. La mise en place est hésitante, le romantisme exacerbé de la partition manque plus d’une fois se transformer en sentimentalisme savonneux (glissandi à tous les étages), les vibratos sont négociés avec la fougue d’un retraité abordant un virage de départementale de la Mayenne au volant d’une Aixam sans permis. Les musiciens semblent s’être donné le mot pour brider leurs crescendos (s’agissait-il de ménager l’ingénieur du son cardiaque ?), et la magie n’opère qu’en de trop rares passages – ici une dentelle de pizzicati, là une foucade rythmique habilement amenée.
Pourtant, ce soir de 1986, calé devant les enceintes de ma chaîne Pioneer, je suis dès les premières mesures embarqué dans un paysage sonore fascinant, voluptueux, menaçant. Je ne découvrirai que plus tard le poème de Richard Dehmel, lourd de symbolisme vénéneux (il n’est que brièvement évoqué dans le livret, réduit à sa plus simple expression), mais la musique de Schönberg me dit tout de sa noirceur et de son ultime lumière. Et le complément de programme achève de me filer le frisson, d’autant que je n’ai pas remarqué sur la tracklist qu’une soprano s’invite dans les derniers mouvements du Quatuor n°2. La voix de Marie-Thérèse Escribano qui, sans préavis, résonne dans ma chambre me vaut un jump scare que je situe, rétrospectivement, entre la scène de la douche de Psychose et la découverte du sujet de philo au bac 1989.
Alors, certes, il me faudra attendre les versions des Prazak, des Berg, des Talich ou même du Nash Ensemble pour entendre la fièvre, l’urgence, l’inquiétante étrangeté, et l’opéra latent de cette grande partition post-romantique. Mais, à tout prendre, je préfère l’approche de mes Ramor timorés, la rondeur de leur signature sonore, à la froideur clinique des Arditti ou au tranchant hystérique des LaSalle. Et tant pis si, quelques années plus tard, je verrai leur version tristement recalée dès le premier tour d’une écoute comparée dans le Répertoire des disques compacts de Georges Cherière (verdict couperet des critiques : « probe ») : la Nuit des Ramor continue de briller d’un éclat singulier dans ma discothèque de mélomane quasi quinquagénaire.
(Et vous savez quoi ? Leur intégrale Bartók, rééditée chez Denon, tient sacrément la route !)