Michelle Poncet ou la « Destouches-Lobreau », directrice de l’opéra de Lyon au XVIIIe siècle, par Anne Le Berre – D’argent bien plus que de musique…
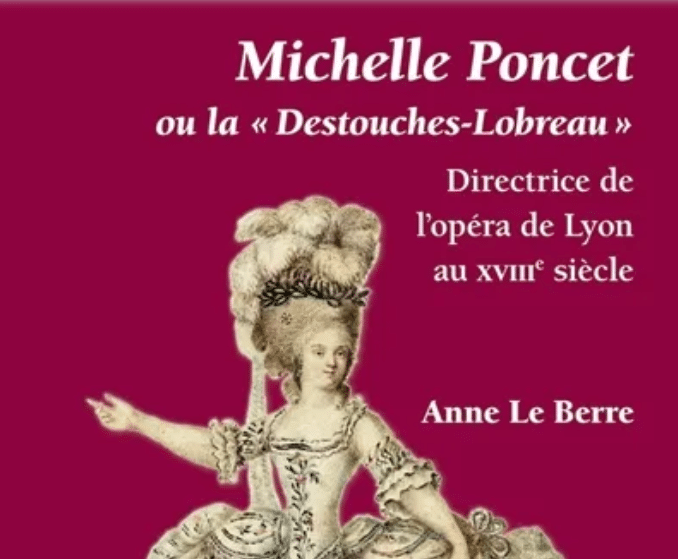
Quelques mises en garde s’imposent avant de parler de l’ouvrage que viennent de faire paraître les éditions Symétrie. D’abord, contrairement à ce que le titre pourrait laisser croire, il ne s’agit en aucun cas d’une biographie au sens où l’on entend ce terme d’ordinaire. En effet, même si l’on connaît ses années de naissance (1720) et de décès (1784), on ignore pratiquement tout de la vie personnelle et privée de Michelle Poncet, dite Destouches, épouse Lobreau. Et comme nous ne sommes plus au temps des vies romancées, riches en anecdotes aussi croustillantes qu’apocryphes, il ne faut rien attendre de ce livre sur ce plan-là. On ignore jusqu’à la physionomie de la « Destouches-Lobreau » (encore qu’un rapport de police la qualifie en 1751 de « grosse fille blonde » ; la belle illustration de couverture n’est nullement un portrait de la dame, mais une étude de costume d’opéra dessinée par Moreau le Jeune en 1781, soit d’un après que l’intéressée avait pris sa retraite officielle.
Autre caveat indispensable : de musique, il n’est qu’assez peu question dans ce volume, pour plusieurs raisons. D’une part, on connaît mal le répertoire présenté au Grand-Théâtre de Lyon inauguré en 1756, et donc durant les trois décennies où la Destouches-Lobreau assura la responsabilité des spectacles musicaux dans la capitale des Gaules. D’autre part, les partitions ont rarement été conservées, et lorsqu’il est question d’œuvres ayant connu leur création à Lyon à cette époque, il s’agit en grande partie de comédies mêlées d’ariettes reprenant des « timbres » alors familiers du public. Par ailleurs, ce que l’on sait de l’orchestre du Grand-Théâtre de Lyon, qui oscilla entre quinze et vingt-cinq instrumentistes, laisse présager que l’aspect strictement musical des spectacles n’était peut-être pas le plus remarquable.
L’intérêt du livre d’Anne Le Berre est ailleurs, et le dépouillement des archives auquel elle a procédé débouche sur une étude qui se penche d’abord sur les aspects juridiques, politiques et financiers de la période pendant laquelle le privilège de l’Académie royale de musique de Lyon fut détenu par la Destouches-Lobreau, soit entre 1752 et 1780, avec une brève interruption de 1761 à 1764. Ce que montre fort bien cette étude, et qui sera sans doute une découverte pour beaucoup, c’est que le XVIIIe siècle fut « une période unique de visibilité à l’opéra pour les femmes » (6), un moment exceptionnel « de libéralisation, de liberté, d’autonomisation » (145), pendant lequel des femmes purent prendre en leur nom propre la tête d’institutions de divertissement (un décret de 1824 allait y mettre officiellement fin, mais l’Empire avait déjà écarté les directrices de théâtre).
Un mot revient très souvent sous la plume d’Anne Le Berre : « stratégies ». En effet, elle s’intéresse à tous les moyens mis en œuvre par la Destouches-Lobreau pour se maintenir dans la position qu’elle avait su conquérir. Le Grand-Théâtre était pour la ville de Lyon un « instrument de rayonnement », et il était essentiel qu’il soit bien géré, notamment en recrutant de bons éléments pour sa troupe incluant comédiens, chanteurs et danseurs, afin de satisfaire tant le public que les édiles. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la résolution de cette équation passait par la mise à l’affiche d’un nouveau genre conquérant, au lendemain de la Querelle des Bouffons : l’opéra-comique, beaucoup moins exigeant que le grand opéra sur le plan des moyens artistiques et financiers. C’est ce qu’on appelait en province « l’opéra-bouffon », avec ses héros paysans ou valets, choix pragmatique qui permit à la directrice de l’opéra de Lyon de réussir, même si, déjà à l’époque, l’institution fonctionnait avec un déficit constant…